Entretien avec Romaric Sangars : Les verticaux
Livres Mauvaise Nouvelle https://www.mauvaisenouvelle.fr 600 300 https://www.mauvaisenouvelle.fr/img/logo.png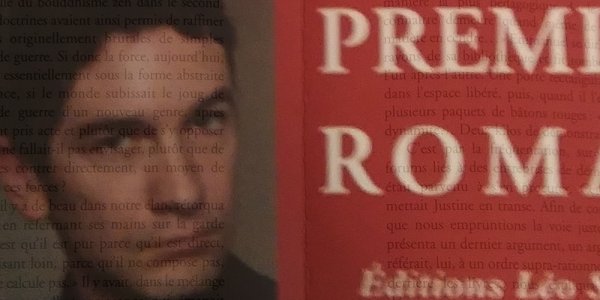
Entretien avec Romaric Sangars : Les verticaux
Mauvaise Nouvelle : Quelque chose au début de votre roman, les verticaux, m’évoque un peu Les chemins de la liberté de Sartre, avec ces jeunes gens conscients de leur indigence, de leur impuissance à agir, ne parvenant plus réellement à être des « animaux politiques ». Puis, le livre se transforme au sens où il semble en engendrer un autre, plus initiatique, plus aventurier. C’est comme si nous passions d’Œdipe à Perceval le Gallois de façon quasiment insensible. Aviez-vous l’intention d’illustrer la reverticalisation possible de la littérature, de dire par l’histoire que vous racontez, la nécessité que la littérature soit autre chose aujourd’hui que ce divertissement indolore ou le récit quasi hygiéniste de la vie de ses entrailles ?
Romaric Sangars : Les Verticaux est un roman qui pose la question des types humains développés par notre époque, et des modèles que celle-ci érige. Parce que si le progrès technique et matériel est une évidence et, par ailleurs, l’argument de choc du monde moderne, la qualité des individus, au contraire de celle des objets produits, semble plutôt s’amenuiser. Je ne sonde ni les reins ni les cœurs et je ne pose pas ici un jugement moral, mais je parle d’ampleur, de profondeur, d’élan, de puissance de caractère. Les nouveaux types humains qui sont cultivés par l’environnement qui est le nôtre sont toujours plus narcissiques, étriqués, prostrés dans la matière. J’ai voulu mettre en scène des êtres qui, au contraire, touchaient aux modèles archaïques bien connus qu’on retrouve également dans la célèbre trilogie baudelairienne : le poète, le prêtre, le guerrier, pour les opposer aux nouveaux modèles que mon narrateur, Vincent Revel, côtoie régulièrement par son métier de journaliste portraiturant les célébrités du moment. Lui-même voudrait assumer une vocation d’écrivain, mais je dirais qu’il s’est laissé désespérer par l’ambiance environnante, et c’est sa rencontre et sa fréquentation de deux êtres reliés aux précédents archétypes qui vont lui communiquer l’énergie nécessaire à accéder au sien propre : Lia Silowsky, qui vit une forme de mysticisme à l’état d’ébauche et connaît des transes diverses ; Emmanuel Starck, un jeune aventurier attelé à l’œuvre de se forger lui-même plutôt que de développer une carrière, et qui se réclame d’idéaux chevaleresques. Le glissement dont vous parlez tient à ce que Revel, qui se vit d’abord comme isolé, amer, étranger au monde qui l’entoure, une fois relié à ces deux êtres, va pouvoir entrer dans une forme active de conspiration. Celle-ci vise à tenter de se re-verticaliser à rebours de toutes les influences du monde. Mais par ailleurs, et de manière bien davantage implicite, il est question, en effet, et c’est heureux que vous le remarquiez, de redonner à la littérature une perspective totale, bien loin du divertissement général et du remugle égocentrique. Revel parvient enfin à écrire, et moi, à travers lui, parce qu’il a reconnecté le langage à deux de ses garanties essentielles. Une garantie métaphysique, qu’incarne Lia, c’est parce que tout est langage divin en son essence que l’acte d’écrire peut se rattacher à un mystère qui le dépasse et l’éclaire. Une garantie physique, que représente Emmanuel en brandissant à nouveau la vieille idée de l’honneur, une idée qui a étrangement disparu du catalogue des vertus, correspondant précisément à la volonté de défendre la signification de certains mots sacrés, et violemment si nécessaires. Par un côté, le langage est justifié d’en-haut, de l’autre, on reformule l’importance d’assurer son impact ici-bas. Alors, le poète peut à nouveau essayer d’en déployer les possibilités hors du bavardage, de l’exhibition et de la dérision qui représentent, aujourd’hui, les catégories principales au sein desquelles il se dégrade.
MN : Votre roman, Les verticaux, m’apparaît comme une sorte de recherche d’une conversion, d’une dignité. Et cette quête n’est pas un cheminement individuel, une distinction personnelle, mais une aventure dans le monde. Pour combattre la doctrine qui « prétend que tout est matière, nombre, transaction », vos héros semblent ressentir l’urgence d’annoncer la mauvaise nouvelle (l’expression m’est chère), et de passer à l’action directe. Ils auraient pu choisir de faire sécession, de quitter le monde, de se choisir une retraite. Au lieu de ça, ils se choisissent un combat perdu d’avance, comme s’ils ne pouvaient combattre le monde sans se sacrifier, comme s’ils étaient suffisamment assimilés au monde, salis par lui, pour accepter le sacrifice de couler avec lui. La recherche d’une mort héroïque, d’une mort honnête, a-t-elle succédé à l’espérance d’une bonne mort ?
RS : L’obsession de mes personnages est de se rattacher à des dimensions supérieures devenues aujourd’hui, du point de vue de la sphère mentale officielle en tout cas, à peu près incompréhensibles. Chacun d’entre eux est lié à une dimension particulière, mais tous la vivent en effet comme une aventure dans le monde, moins comme une possibilité d’exil que comme une position d’assaut. Ce n’est pas tant, je crois, qu’ils imaginent leur combat perdu d’avance. Ils savent, d’abord, qu’ils sont dans une position d’infériorité radicale et qu’ils ne peuvent, dans un premier temps, que développer une forme de guérilla symbolique au sein de la plus asymétrique des guerres. Ils décident, ensuite, de ne pas se placer sur le même plan que l’ennemi, si je puis dire. Ils se situent depuis l’affirmation transcendante, et de là, la question du succès, immédiat ou non, devient secondaire. Ensuite, sans vouloir non plus dévoiler l’intrigue au potentiel lecteur, s’il y a quelque chose de tragique dans leur évolution, cela ne tient pas à une volonté spécialement sacrificielle de mes personnages, plutôt du poids du contexte. Mais qu’ils ratent ou non dans leurs entreprises, ils auront néanmoins hissé quelque chose. Ils seront parvenus à vivre à une certaine hauteur en un temps où la gravité exerce décidément une attraction terrible.
MN : On peut faire un parallèle entre les héros des Verticaux et le retour du monde dans l’Histoire à l’aune de ceux qui sont restés figés au VIIème siècle, à savoir les islamistes. Vos héros lancent des actions terroristes pour troubler « la fête du capitalisme », et se font comme « doubler » par les djihadistes précipitant le monde dans une guerre civile mondiale. Vos héros ne se sont-ils pas trompés de combat ? Enfants des années 80, n’ont-ils pas cru à un monde postmoderne sorti de l’histoire, sans voir les nouveaux combats émerger, les nouveaux théâtres d’opérations dignes des héros qu’ils veulent être, se créer ?
RS : Mais la sortie de l’Histoire est tout autant le fantasme de l’Occident depuis la Chute de l’Empire soviétique (lequel visait d’ailleurs un but identique), que celui des islamistes radicaux, qui veulent éterniser de manière totalitaire un moment selon eux cardinal de la coïncidence de la société humaine avec la volonté divine. En réalité, tout le monde veut en finir avec l’Histoire, du moins toutes les religions politiques, et le capitalisme en est une, comme avec le défi de l’existence incarnée. Mes personnages souhaitent justement le relever, eux, ce défi, en élaborant une posture adéquate. Cela dit, il est vrai que leur révolte depuis l’intérieur de leur monde est subitement débordé par la violence islamiste. C’est là évidemment l’événement majeur qui s’est produit ces dernières années. Dans un monde comme le nôtre, la violence est devenue totalement inacceptable, dans son expression directe du moins, même la fessée éducative (je pense que l’érotique est sauve) s’est vue criminalisée par la loi et de prétendues « stigmates » se multiplient à un rythme effréné dans des consciences tellement faibles que l’État devrait veiller en permanence à ce qu’on ne les offense pas (moi, à vrai dire, presque tout m’offense, dans cette époque, et je n’éprouve pas ce besoin ridicule de porter plainte à tout bout de champ afin de faire « reconnaître ma souffrance » par papa-juge, ce qui est l’un des symptômes de l’infantilisation générale). Or, dans ce contexte où le commerce et le droit devraient circonscrire à jamais toutes les tensions, et où homo festivus tient à obliger chacun et en toute circonstance à arborer un « sourire sympa » similaire à ces émoticônes qui ont envahi nos écrans, on vient subitement massacrer des civils à la kalachnikov. Alors certes, la révolte de mes personnages, en comparaison, semble totalement dépassée. Mais c’est la réalité qui est devenue purement schizophrène. Eux tiennent simplement une ligne cohérente.
MN : Emmanuel Starck, l’ami de Vincent Revel, votre héros, « n’a aucune utopie à offrir, seulement une manière exaltante d’envisager le tragique de vivre. » Et effectivement, nous oscillons dans les actions directes du petit groupe entre farce et tragédie. Parviennent-ils réellement à ne pas être contaminés par le pathétique ? Parviennent-ils à se distinguer du monde et de son mélodrame ? Ou ne sont-ils, au final, que des sous-produits de ce qu’ils dénoncent ? « Le grand rire libérateur » parvient-il à s’extraire du « ricanement qui sape et rabaisse et relativise » ?
RS : C’est au lecteur de juger. Mais quant à moi, je pense qu’ils échappent à ce qu’ils dénoncent, oui. Simplement, leurs trajectoires ne peuvent sans doute pas obtenir des issues éclatantes ou concrètes, parce qu’ils ne sont qu’une poignée. On peut leur reprocher de n’être au fond que des Parisiens dilettantes et semi-alcooliques, ce n’est pas totalement faux, mais en dehors du fait que Paris m’intéresse comme sujet littéraire, tout l’intérêt de la situation qui est la leur est de se trouver au cœur du système d’élaboration de nos valeurs. Enfin, leur ligne est cohérente malgré tout, je le disais, jusqu’au tragique, c’est ce qui les entoure comme monde ou comme contre-monde officiel qui tient systématiquement de la farce, pas eux. La farce spectaculaire d’un côté, la farce sanglante de l’islamisme de l’autre. Parce que si les conséquences des attentats sont évidemment tragiques, il n’empêche que se grimer en héros de Dieu alors qu’on se contente de tirer sur les clientes d’un bar, qu’on se fait exploser seul parce que c’est l’heure, qu’on écrase des enfants un jour de fête sous les roues d’un poids lourd, ou qu’on a besoin de l’alliance de deux jeunes suicidaires pour égorger un pauvre prêtre octogénaire, tout cela relève surtout du Grand Guignol morbide.
MN : En finissant votre roman, il y avait comme un ressenti que tout cela était nécessaire, que la tragédie appelait chacun d’entre nous, et qu’accepter de devenir un organe du grand tout n’était pas digne de la nature humaine. Le roman peut-il engendrer le réel ? Avez-vous pensé un moment devenir ce que vous écrivez ? N’y-a-t-il jamais eu ce fantasme d’aller au bout de l’écriture ?
RS : L’avantage de la forme romanesque, c’est qu’elle offre comme un laboratoire où peuvent être expérimentées des trajectoires, des collisions, des métamorphoses particulières. Ces expériences ont fatalement des résonances dans le réel, au moins dans le réel du chimiste, le reste demeurant imprévisible. « D’où parles-tu, camarade ? », demandait-on dans les années 70. « D’où veux-je écrire ? », était sans doute la question inconsciente qui présida à l’expérience des Verticaux. Une fois celle-ci accomplie, je peux donc affirmer : « Depuis le feu de cette révolte métaphysique, entre Emmanuel Starck et Lia Silowsky, installés dans l’appartement des morts, et à l’attention des vivants croisés au hasard dans la rue. »




