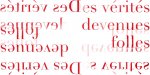Rémi Brague : Où est la morale ?
Livres Mauvaise Nouvelle https://www.mauvaisenouvelle.fr 600 300 https://www.mauvaisenouvelle.fr/img/logo.png
Rémi Brague : Où est la morale ?
Rémi Brague est philosophe. Universitaire de confession catholique, ce dernier se distingue par ses écrits érudits dénués de jargon. Polyglotte, l’auteur aborde au sein de textes foisonnants tout autant les monothéismes abrahamiques que les classiques du paganisme gréco-romain. Dans son dernier livre, La morale remise à sa place (Gallimard, 2024), Rémi Brague questionne la notion de « morale » : il s’agit de la cerner tout en essayant de comprendre pourquoi celle-ci prend aujourd’hui le masque du moralisme. Un ouvrage magistral.
D’emblée, il s’agit pour l’auteur de montrer que la quantité et la pression de la morale sont constantes au sein de chaque société, seul son point d’application se déplace. Pour un Grec, le plus important est d’être le meilleur ; pour un Hébreux, honorer son père et sa mère ; pour un Perse, bien tirer à l’arc et ne jamais mentir. Cependant, on ne peut tirer de ces observations un quelconque relativisme moral. En effet, les vertus demeurent des vertus, les vices demeurent des vices, peu importe la culture où l’on se place : à part certains cas marginaux, il est toujours mal vu de mentir, de commettre un meurtre ou un adultère, et il vaut mieux être un bon élève qu’un cancre notoire. Bien évidemment, les motifs de la réprimande peuvent varier pour un même vice. Au Moyen-Age, le plaisir solitaire n’est pas bien vu, surtout dans un cadre monastique, néanmoins on le considère avec indulgence ; au XVIIIe siècle, il est considéré comme un vice à bannir pour des raisons physiologiques : Samuel Tissot attribuait à celui-ci le pouvoir de rendre sourd, voire de mener à l’extinction de la race humaine.
De plus, l’auteur pointe une tendance dans l’histoire occidentale de ces derniers siècles : il existerait un « vaste mouvement de moralisation ». Ainsi, l’esclavagisme qui semblait être un fait de nature devint une pratique sociale à proscrire en cela qu’il déroge à la dignité humaine ; de la même façon, la peine de mort, la torture, la prostitution, et l’usage de drogues furent de plus en plus exposés à la critique. Si Rémi Brague voit dans celle-ci une évolution, il n’en souligne pas moins les limites : une morale débridée se transforme rapidement en un moralisme dont les bonnes intentions mènent à des situations infernales. Lorsque l’Etat absolutiste de l’Ancien Régime abolit le duel entre aristocrates, il envoie les nobles au casse-pipe sur les champs de bataille. Egalement, le philosophe attire notre attention sur le fait que les intentions des entrepreneurs moraux sont parfois empreintes d’immoralité : si l’un d’entre eux œuvre à abolir la torture n’est-ce pas pour obtenir des aveux sincères plutôt que par volonté de diminuer les souffrances du supplicié ? Lorsque les partisans de la prohibition interdisent la consommation d’alcool aux Etats-Unis n’est-ce pas en raison d’une xénophobie latente envers les nouveaux arrivants slaves et latins, enivrés de vodka ou de grappa ? Difficile de ne pas songer ici à la maxime de La Rochefoucauld « nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés ».
Aujourd’hui, nous pouvons assister à une situation paradoxale : si la morale n’a pas bonne presse, « il est interdit d’interdire », le moralisme triomphe sans rencontrer de résistance. Une petite musique moralisante assourdissante inonde nos discours. Nous pouvons parler de véritable obsession. Or, cette moraline est particulièrement odieuse puisque contrairement à la morale religieuse, elle ne laisse aucune place au pardon ; nous ne pouvons espérer aucune absolution des nouveaux clercs. En effet, si les actes peccamineux pouvaient être corrigés, les accusations contemporaines portent sur ce que sont les personnes en tant que telles ; dans une telle configuration, il est difficile de se débarrasser de nos tares, à savoir notre sexe, notre couleur, ou encore les exactions commises par nos ancêtres. La haine de soi et de son passé « ne pardonne pas », c’est le cas de le dire. Cette nouvelle morale intransigeante est d’autant plus problématique lorsqu’elle s’incarne dans le terrorisme : durant la Révolution Française, la vertu s’impose à l’aide de la guillotine, il s’agit pour les révolutionnaires de « prévenir tout vice », d’apprivoiser l’homme (Morelly) en mettant sur pied un plan d’éducation nationale. De nos jours, le fanatisme religieux impose la terreur au nom de préceptes monothéistes ; il s’agit de punir les méchants impies en les supprimant.
A présent, étudions les éléments constitutifs de la morale dégagés par l’auteur.
Des réquisits de la moralité
Tout d’abord, Rémi Brague nous fait remarquer que la moralité porte toujours envers quelqu’un. Ainsi, lorsque nous nous assurons de bien restituer à autrui un bien qu’il nous a confié ; lorsque nous aidons une personne en difficulté, nous faisons preuve de moralité. Dans le contexte écologique qui est le nôtre, il arrive qu’une entité non-humaine soit hissée au rang de personne : certains animalistes récusent toute différence de degré entre les hommes et les animaux, affirmant qu’ils ont des droits. Aussi, c’est notre planète Terre qui se voit assimilée à une déesse grecque Gaïa : l’extension du statut de personne peut aller très loin, quitte à englober des choses naturelles tel un fleuve, une montagne. Bref, la morale est toujours tournée vers quelqu’un.
Dans une action éthique, un sujet est toujours engagé : « j’agis, c’est moi qui agis » écrit l’auteur. Embarqué dans un espace-temps limité, la personne agit dans un moment donné irremplaçable et qui n’adviendra plus jamais, les Grecs nommaient cela le kairos. L’expérience du sujet est immédiate, il ne peut se défausser sur un autre : profondément responsable, ce dernier doit pouvoir répondre de ses actes. Si cette charge peut sembler écrasante, il s’agit du lot de notre liberté. Cette conception d’un sujet abandonné à lui-même a formé la trame d’un certain nombre d’œuvres existentialistes : difficile de ne pas songer ici aux ouvrages de Kafka. Cependant, l’angoisse peut être canalisée : au sein de « morales raides » (Péguy), l’incertitude liée à notre liberté semble moins lourde à porter. Les privations et les rites, s’ils sont désagréables, nous aident à nous sentir du bon côté et en règle. Le sujet est moral en fonction de l’intention qui préside à ses actions : orientation du cœur, c’est elle qui nous fait bien agir. En effet, nous avons beau être dotés d’une grande technique liée à notre profession, par exemple l’habileté du médecin à soigner ses patients, nos actes ne peuvent être coupés de l’intention qui les précède.
En outre, il est difficile de considérer la question de l’acte moral indépendamment des règles morales : si nous souhaitons agir selon le bien, nous devons nous référer à un critère. Peu importe que nous agissions avant de penser ou inversement, le sujet revient toujours sur son acte et émet un jugement à son propos. Très rapidement se pose la question de l’universel : que ferait-on à ma place ? Si un élève gourmand dépasse ses camarades à la cantine, il s’exposera aux remarques désagréables de ceux-ci : « Si tout le monde faisait comme toi ! ». S’il avait bien agi, il aurait pensé à l’impératif catégorique énoncé par Kant : agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse servir de principe pour toute législation universelle. Si la conception universelle fut vivement critiquée, notamment par le crédit qu’elle accorde à la responsabilité permettant l’imputabilité d’une faute à un criminel, elle reste une platitude dans nombre de cultures : ainsi, la règle d’or, selon laquelle « il ne faut pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse », se trouve aussi bien dans la tradition chinoise, hindoue, que juive. Peu importe où il se trouve, le sujet doit agir de façon morale.
Attardons-nous sur le modèle chrétien de la morale qui intéresse particulièrement l’auteur.
Tout homme est mon prochain
Rémi Brague distingue trois modèles d’éthique qui s’appliquent au sein de l’expérience humaine. La première, « sociopolitique », correspond au rapport que nous pouvons entretenir avec un partenaire ; le second, « ascétique », traite de l’éthique comme acte d’un sujet ; le troisième, « légaliste », est en rapport avec le respect d’une règle, particulièrement dans un cadre religieux. A la suite des ces discriminations, le philosophe s’attarde sur le modèle chrétien ; ce dernier l’intéresse particulièrement, étant lui-même de confession catholique. Celui-ci a aussi l’avantage d’effectuer une synthèse des modèles d’éthique énoncés ci-dessus.
D’emblée, il s’agit pour le philosophe de montrer ce qui rapproche le christianisme de la morale commune : concernant les « platitudes premières » (C.S Lewis), cette religion n’a rien d’original. Tout est contenu dans les Dix Commandements reçus par Moïse sur le Mont Sinaï. En revanche, sur le plan vestimentaire, le christianisme laisse ce genre de détails à la discrétion de l’intelligence des hommes : aucun commandement christique ne porte sur la façon dont un homme doit tailler sa barbe, sur le genre d’aliments à proscrire ou à cuisiner, sur la manière dont une femme doit couvrir sa tête, ni concernant une médecine particulière à pratiquer plutôt qu’une autre. En cela, le Christ rompt avec l’orthopraxie juive pour qui chaque aspect de la vie humaine doit être soumis à une réglementation religieuse. La circoncision du sexe laisse place à la circoncision du cœur. Egalement, le domaine d’application des comportements moraux excède le cercle étroit des adeptes de cette religion : selon cette perspective unique, tout homme est mon prochain. Si l’ethnocentrisme reste un invariant anthropologique, consacrant la séparation de l’humanité entre les nôtres et les autres, le Christ porte un message d’espérance universel qui ne connaît aucune frontière. Dans sa Lettre à Arsakios, l’empereur Julien dit « L’Apostat » considère qu’il est honteux que les chrétiens nourrissent autant les miséreux croyants que les miséreux païens : les Gréco-romains aristocratiques ne doivent pas se compromettre avec les chrétiens vulgaires qui n’établissent pas de rangs entre les hommes. Cette charité mène parfois ses bénéficiaires à en abuser : Lucien, auteur satirique romain, a notamment décrit la figure de l’escroc Peregrinus Proteus profitant de son accueil par les communautés chrétiennes de l’époque. En dépit de ces excès, Rémi Brague réaffirme le principe inviolable selon lequel il vaut mieux de nombreux abus que de laisser moult nécessiteux mourir de faim. Le modèle sociopolitique chrétien est donc toujours axé sur la joie collective : si le plaisir est souvent solitaire, à l’image du vice qui isole, la joie est essentiellement communicative.
Concernant l’ascèse, une certaine vulgate accole au christianisme un tas de défauts, souvent à tort. Ainsi, le dolorisme chrétien inciterait les fidèles à toutes les meurtrissures physiques possibles. Or, ce cliché éculé a bien plus à voir avec un certain néo-platonisme ou avec le gnosticisme : temple de l’Esprit-Saint, le corps est bon et il se doit d’être respecté. Dans le cas où celui-ci est rudoyé, c’est toujours en dernière instance l’âme qui est visée par l’éducation ascétique.
Enfin, le légalisme chrétien n’a rien d’une obéissance aveugle à un code de comportement impersonnel : la loi vient de Dieu, et elle montre Dieu ; plus précisément, elle règle la vie à l’intérieur d’un espace divin. Nous l’oublions souvent mais l’obéissance à Dieu renvoie étymologiquement au fait d’« écouter » (ob - audire) le Seigneur : il s’agit de se familiariser avec lui tout en essayant d’entrer dans ses vues. Le Christ l’avait affirmé, il est venu sur Terre pour emplir la Loi juive : le plus important reste la Loi pleine de l’Esprit où l’intention du législateur prime sur la lettre morte de la loi.
Précis et concis, l’ouvrage de Rémi Brague s’attarde sur la morale, notion problématique dont les défenseurs contemporains travaillent à la dévoyer en moralisme accusateur. Étudiant avec précision ses différentes manifestations, le philosophe nous aide à y voir plus clair. Au moment où tout est soumis à un jugement impitoyable, (re)lire ce texte est capital.