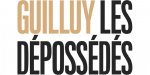Le « Mertvecgorodverse » sans limite de Christophe Siébert
Livres Mauvaise Nouvelle https://www.mauvaisenouvelle.fr 600 300 https://www.mauvaisenouvelle.fr/img/logo.png
Le « Mertvecgorodverse » sans limite de Christophe Siébert
Christophe Siébert est un habitué de la scène underground alternative. Ses livres influencés par le roman noir, la science-fiction et l'horreur. Son roman Métaphysique de la viande, obtient le prix Sade en 2019. À partir de 2020, il s'engage dans la rédaction des Chroniques de Mertvecgorod dont fait partie Une vie de saint, ce nouvel opus publié Au diable vauvert.
Grégory Rateau : Dans plusieurs de vos romans, dont votre petit dernier, Une vie de Saint, vous avez créé une géographie imaginaire pour y déployer votre univers, y faire évoluer vos anti-héros, en repoussant de fait les limites du réel. Parlez-nous de votre ambition de faire germer d’autres mondes, même si ancrés dans notre époque ?
Christophe Siébert : Ça faisait très longtemps que je voulais fabriquer un décor qui puisse servir de liant à tout ce que j’avais à raconter. J’avais envie d’une ville qui soit assez ouverte et riche pour que je puisse y situer aussi bien des polars que des bouquins d’horreur, des drames intimistes que des trucs de bagarre cyberpunk, et qui soit assez complexe, excitante et romanesque pour qu’elle puisse exister en tant que personnage à part entière, dont les lectrices et les lecteurs découvriraient, livre après livre, toutes les facettes. Le premier livre se passant dans cette mégapole, qui est la capitale d’une minuscule république coincée entre la Russie et l’Ukraine, est paru en 2020. Aujourd’hui vient de paraître le septième titre se déroulant dans cet univers. Une vingtaine de volumes sont prévus en tout et chacun peut se lire de façon indépendante.
Paradoxalement, mes modèles n’ont pas été les créateurs des grandes cités imaginaires qui peuplent la littérature, mais au contraire les auteurs qui se sont emparés de villes réelles pour se les approprier. Je veux dire par là que ma façon de fabriquer et faire vivre Mertvecgorod doit davantage au Paris de Léo Malet ou au Los Angeles d’Ellroy qu’à Arkham, par exemple.
Toute l’astuce, de mon point de vue, consiste à oublier (à faire semblant d’oublier) que je parle d’une ville qui n’existe que dans ma tête et à me persuader que je raconte livre après livre les grandes et les petites histoires d’une cité réelle, où j’habite vraiment. Dans la mesure où je connais mieux Mertvecgorod que Bucarest, où je suis installé depuis quelques mois, ou que Clermont-Ferrand, où j’ai vécu dix ans avant de partir en Roumanie, je crois que j’ai réussi mon coup.
Mais alors, me direz-vous, pourquoi ne pas directement prendre une ville réelle au lieu de m’emmerder à en bâtir une de A à Z ? Tout simplement pour les possibilités de dialectique entre la narration et le contexte qu’offre un décor imaginaire et que ne permet pas un décor réel. Je m’explique : s’il est important pour mon histoire que les métros fonctionnent de telle manière et pas de telle autre, si les éboueurs (je pense à ça parce que c’est un axe du manuscrit que je suis en train d’écrire en ce moment) possèdent telle ou telle particularité culturelle essentielle à mon ambiance, je ne veux ni devoir tordre la réalité pour coller à mon histoire (si je situe mon histoire à Berlin, par exemple, où les métros et les éboueurs sont ainsi et pas autrement), ni l’inverse. Sitôt que je maîtrise chaque détail de mon décor, je fais ce que je veux et c’est une liberté fantastique – qui oblige aussi à une certaine rigueur pour éviter les incohérences d’un bouquin à l’autre, évidemment !
Grégory Rateau : Que représente pour vous ce Mertvecgorod ? Une fascination bien réelle pour une mythologie, une culture, voire pour une esthétique soviétique ?
Christophe Siébert : Je n’avais pas l’intention au départ de situer cette ville dans cette région du monde. J’ai d’abord établi une sorte de cahier des charges, correspondant aux atmosphères que je voulais installer et aux histoires que je commençais à avoir envie de raconter. Il me fallait notamment une ville très étendue, très peuplée et dont l’histoire pouvait se compter en siècles, voire davantage, puisque j’avais aussi besoin des ruines d’une cité antique sur laquelle la ville moderne avait été bâtie.
C’est donc en procédant par élimination que je suis arrivé dans cette partie du monde. L’Amérique du Nord c’était impossible parce que l’urbanisation est trop récente, l’Europe c’était impossible parce que je ne voyais pas bien où caser une mégapole de cette taille sans que ça soit ridicule, l’Amérique du Sud ça me plaisait bien mais j’avais déjà pas mal pompé l’histoire réelle de Mexico pour construire certains arrière-plans et soubassements de mes récits et je voulais éviter que ça soit trop visible ou redondant, l’Afrique et l’Asie me semblaient trop loin de mes bases, j’avais peur de raconter cinquante conneries par page si je situais mon décor dans des endroits que je connais aussi mal ; la Russie s’est donc imposée par simple pragmatisme et, parmi tous les endroits possibles en Russie, ce coin du sud-ouest, presque à la frontière de l’Europe, m’a paru le mieux pour une raison toute bête : le climat par là-bas était proche de ce que je connaissais – je veux dire, ça n’était pas la Sibérie. Et, franchement, je savais que j’aurais déjà tellement de choses à penser, à intégrer, à apprendre ; si je pouvais être relax sur la météo, c’était tout bénef.
Ensuite, évidemment, et dans la mesure où j’ai passé un peu plus d’un an et demi, peut-être deux ans, à réfléchir à Mertvecgorod et à prendre des notes avant de raconter la moindre histoire, le contexte géographique, culturel et historique et à me passionner pour ce coin du monde, à me documenter beaucoup sur le goulag, sur la vie quotidienne dans l’URSS des années 80, sur le post-soviétisme, etc. J’ai au passage découvert toute la musique électronique, punk, post-punk, goth, indus, expérimentale, bizarre, etc. pour les besoins de mon roman Valentina, et ça a été un tel coup de foudre que depuis trois ou quatre ans je n’écoute plus que ça.
Grégory Rateau : Pour les lecteurs qui ne vous ont pas encore lu, pouvez-vous nous parler des ramifications possibles entre vos différents romans ?
Christophe Siébert : Les ramifications entre les différents livres de la « saga » Mertvecgorod sont très nombreuses. Les lieux, les personnages, les événements se croisent sans cesse et les points de vue varient constamment. Il y a des contradictions, des incohérences. Les récits prennent différentes formes : certains se présentent comme des romans, d’autres se présentent comme des enquêtes, ou des essais publiés à Mertvecgorod et traduits en France, etc. Tout ça vise à renforcer l’impression de réalité générée par l’ensemble. C’est un peu comme quand on s’intéresse, par exemple, au terrorisme d’extrême-gauche tel qu’il a eu lieu en France à la fin des années 70. On va pouvoir lire des tas de bouquins très différents sur le sujet, selon que les auteurs soient d’un bord ou d’un autre, selon que ce soient des ouvrages politiques, historiques ou des polars, selon qu’ils choisissent comme angle d’attaque Action directe, ou plutôt le SAC, ou plutôt la pègre, etc. Mon ambition, c’est de prendre Mertvecgorod entre 1970 et 2050 et, à force d’accumuler des livres qui ont des formes, des sujets et des voix différentes, de créer cette même impression de profusion, de corpus.
Grégory Rateau : Une Vie de Saint est un roman déjanté flirtant avec différents genres littéraires, mais la satire de nos sociétés est bien présente. Quel message conscient (ou inconscient) vouliez-vous faire passer en montrant la descente en enfer de ce Raspoutine contemporain ?
Christophe Siébert : Je n’écris pas pour délivrer des messages (enfin, en tout cas, de façon consciente – pour les messages inconscients, j’invite chacune et chacun à décider, mon inconscient ne m’appartient pas !).
Même en ce qui concerne la satire de nos sociétés, je laisse chaque lectrice et chaque lecteur juger – je ne partage pas nécessairement cet avis. Et d’une façon générale, je ne suis pas certain que la fiction soit le meilleur endroit possible pour faire passer des messages. Ou plus exactement, je crois que l’auteur devrait s’abstenir de délivrer des messages et que si message il y a, il sera généré par la rencontre entre le texte et la personne qui le lit, rencontre bilatérale dont l’auteur est absent de façon notable.
Tout ce que je voulais faire, en racontant la vie (qui peut aussi être vue comme le contraire d’une descente aux enfers, du reste) de ce personnage fortement inspiré par Raspoutine dans les trente ou quarante premières années de son existence, et davantage par Mishima dans les trente dernières, c’est, eh bien, raconter la vie de ce type.
Ce qui m’intéressait en premier lieu en écrivant la biographie fictive de Nikolaï le Svatoj, c’était de jouer avec des narrations, des voix et des genres multiples, puisque le livre compose un portrait du Svatoj à partir de différentes sources : sa biographie non-autorisée écrite par une certaine Veronika Tsiganov, un roman d’horreur à l’auteur incertain (mais possiblement le Svatoj lui-même), des articles de presse, des extraits de correspondance, le journal de prison rédigé par le principal complice et amant du Svatoj dans l’attentat et le coup d’État manqué qui servent de point de départ à toute cette histoire, de larges extraits d’un samizdat politico-ésotérique et quelques autres documents encore, le tout rassemblé (et parfois traduit) par un certain Christophe Siébert.
Grégory Rateau : Vous êtes également directeur de collection dans une maison d’édition qui fait la part belle à la littérature érotico-porno-artistique, vous mettez aussi en avant des « écritures à la marge » dans un recueil de nouvelles intitulé Les nouveaux déviants. Pensez-vous que l’originalité en littérature ne peut exister qu’en dehors du système, dans cette marge précisément (chez des indépendants et des circuits parallèles) loin du politiquement correct et de toute forme de censure ?
Christophe Siébert : Non, je ne pense pas, puisque de formidables bouquins paraissent aussi dans de grosses maisons d’édition et que des merdes paraissent aussi chez les indépendants. Du reste, les éditeurs indépendants n’existent pas hors du système, et c’est tant mieux, parce que moi non plus je n’existe pas hors du système ; par exemple, quand je vais faire mes courses, à la caisse, je paie – alors ça m’arrange de gagner ma vie, parce que j’aime bien manger.
Ce que je crois, en revanche, c’est que les pressions économiques ne s’exercent pas de la même manière sur les éditeurs indépendants (c’est-à-dire qui n’appartiennent pas à un groupe d’édition) et que ça leur permet de publier des livres en étant moins attachés à la nécessité d’une rentabilité immédiate pour chaque titre. Pour résumer de façon abrupte, au Diable vauvert, par exemple, si les bouquins qui se vendent à 10 000 ou 15 000 parviennent à compenser ceux qui se vendent à 500 et qu’à la fin de l’année la maison a un bilan comptable positif, tout baigne. Alors que dans les gros groupes, les directrices et directeurs de collections ont des comptes à rendre à la direction générale, qui elle-même a des comptes à rendre à une hiérarchie, qui elle-même a des comptes à rendre à des actionnaires. Et si ces derniers disent « la poésie, c'est bien joli, mais les livres de cuisines se vendent quand même vachement mieux », alors aurevoir la poésie. Ou si ces derniers disent : « Cet auteur que tu trouves génial et que personne n’achète, nous, on n’en a rien à foutre du génie, vire-le et remplace-le par une traduction », alors bye-bye le génie – et ça, même si le reste de la collection est super-rentable.
En somme, l’avantage de l’édition indépendante, c’est que la personne qui choisit les manuscrits est aussi celle qui signe les chèques et elle n’a de compte à rendre à personne ; bon, elle doit quand même rendre des comptes à la réalité économique, c’est pas toujours marrant non plus.
En revanche, ces histoires de politiquement correct et de censure me passent un peu au-dessus du cigare, je crois. Je veux dire, si le politiquement correct consiste à ne plus dire « Va te faire enculer, sale nègre », parce qu’avant d’être une insulte, ce sont des termes homophobes et racistes, je suis vachement favorable au politiquement correct – pareil si ça pousse les auteurs à se creuser le citron pour peupler leurs bouquins de personnages féminins avec moins de nichons et plus de personnalité.
Ensuite, de la censure, je n’en ai jamais vu, et pourtant, avec ce que j’écris et ce que je publie en tant qu’éditeur à La Musardine, je devrais être le premier au courant. Il ne faut pas mélanger la censure, qui est l’arme utilisée par les puissants afin d’empêcher d’exister des œuvres, et les appels au boycott formulés par des minorités militantes. Quand les féministes créent un scandale (à juste titre à mon avis) parce qu’un type comme Polanski reçoit le César de la meilleure réalisation, il n’est pas censuré. Son film continue d’exister et les millions de son compte en banque ne sont pas saisis. Quand une bande de militantes vénères fait irruption à la librairie Mollat à Bordeaux pour foutre le bordel (à juste titre à mon avis) à une séance de dédicace de Beigbeder, le livre n’est pas retiré de la vente, l’auteur n’est pas jeté en prison, il ne se passe rien. Le pauvre bichon crie à la censure, mais tout ce qui lui est arrivé, c'est que des sales pauvres lui ont gâché la soirée, c’est tout.
Ce que beaucoup de gens appellent la censure ou le retour du politiquement correct, ça décrit en fait simplement ce moment où ceux qui sont habitués à tenir le crachoir et à parler, parler, parler sans jamais être interrompus se font chasser de la tribune par une clique de va-nu-pieds qui estiment qu’ils ont suffisamment écouté comme ça et que c’est leur tour de parler, et si t’es pas d’accord, tiens, voilà deux claques – je trouve ce début de renversement des hiérarchies plutôt réjouissant. Il durera ce qu’il durera.
Grégory Rateau : Essayez-vous de choquer le lecteur, du moins de le bousculer, de le faire s’interroger sur ses propres pulsions, ses zones d’ombre ?
Christophe Siébert : Non. J’essaie de raconter les histoires qui traitent de sujets qui me préoccupent, m’obsèdent ou me fascinent, et de le faire en étant intense, jamais ennuyeux et en suscitant chez les gens qui me lisent des émotions fortes. Je suis content si mes lectrices et mes lecteurs développent en me lisant un regard plus critique et plus empathique à l’égard du monde et de ses habitants, mais ça n’est pas mon but.
Grégory Rateau : Vous semblez aimer vos personnages, même les plus limites et sanguinaires, ne jamais les juger, ce qui leur confère une dimension plus poétique. Je me trompe ?
Christophe Siébert : Je crois effectivement que le rôle d’un écrivain n’est pas de juger ses personnages, mais de les regarder vivre et de tenter de rapporter fidèlement ce qu’il a vu. Vous remarquerez que j’ai employé le verbe « regarder » et non « imaginer ». À mon avis, le travail d’imagination doit s’effectuer avant de commencer à écrire. L’imagination fait partie de tout le travail préparatoire, que j’appelle « l’infusion ». Une fois qu’on commence à écrire, idéalement, il ne faut plus se poser la moindre question narrative et se contenter de relater ce qui se passe, à la manière d’un secrétaire. Chaque fois qu’on doit s’interrompre parce qu’on ne voit pas ce qui se passe, qu’on ne sait pas ce qui se passe, et qu’il faut y réfléchir, l’inventer, alors c’est que l'infusion a été bâclée. La situation idéale, pour moi, est celle où les personnages ont quelques paragraphes d’avance, jamais plus, jamais moins. L’idéal est d’aller le plus vite possible, d’écrire en quelques semaines ce qu’on a mis des mois, voire des années, à infuser. Alors on se retrouve avec un brouillon sans doute assez mauvais, mais où tout est là, où tout est en place : il ne reste plus qu’à travailler la langue, la composition, le rythme, etc., c’est-à-dire à fabriquer de la littérature à partir de ce brouillon.
Grégory Rateau : Parlez-nous de vos influences. Nous avions parlé de Clive Barker en amont pour le côté SM, mais il doit y en avoir une multitude. Les plus importantes, peut-être…
Christophe Siébert : Mes influences sont extrêmement nombreuses, c’est un véritable annuaire qui va de Lovecraft à Bukowski en passant par Despentes, Ravalec, Manchette bien sûr, Goodis, Jim Thompson, Burroughs, Bolaño, Guillaume Dustan, Esparbec, Simenon, Bataille, Dostoïevski, Topor, Philip K. Dick, Ballard, j’en oublie sans doute beaucoup, et il y a aussi les autres arts, Lynch, Ferrara et Cronenberg pour le cinéma, Coil, Current 93, Death In June, Nine Inch Nails, The Residents, Tuxedomoon pour la musique, Bosch, Brueghel, Rothko, Soulages, Giger pour la peinture, Alan Moore, Daniel Clowes, Charles Burns pour la bande dessinée… Je pourrais continuer ainsi pendant des heures et des heures. Et là, je n’ai cité que mes influences les plus prégnantes – en tout cas une partie d’entre elles –, celles dont je ressens la présence dans chacune de mes phrases et que je cite chaque fois que je peux, y compris sous une forme plus ou moins déguisée dans mes bouquins. Mais en réalité, n’importe quelle œuvre de l’esprit, bonne ou mauvaise, peut rebondir d’une manière ou d’une autre contre un neurone et créer un écho, générer une idée, tordre une phrase. Et pas que les œuvres, bien sûr. Une conversation, une scène dont on est témoin, tous les aspects du quotidien. Le truc, c’est d’être disponible. Si on l’est suffisamment, n’importe quoi devient une influence, n’importe quoi peut vous donner du grain à moudre. Il suffit de prendre le métro, d’aller faire les courses, de regarder une merde quelconque sur Netflix et c’est parti, la moulinette mentale se met en route.
Grégory Rateau : Un nouveau roman en cours ? Allez-vous continuer à évoluer dans Mertvecgorod ou vous étendre encore un peu ?
Christophe Siébert : À l’heure actuelle, j’ai cinq manuscrits plus ou moins avancés. Trois sont terminés, un est en pause depuis maintenant deux ou trois ans et je travaille sur le cinquième, que j’espère terminer cette année – ce sera un gros thriller, noir, qui reprend les personnages principaux de Valentina dix-sept ou dix-huit ans après, en 2018, alors que les élections présidentielles risquent de faire basculer Mertvecgorod à l’extrême droite.
A priori, je ne compte pas quitter Mertvecgorod tant que je n’aurai pas terminé de raconter les histoires que j’ai à y raconter – j’en ai encore pour une grosse dizaine d’années, je pense.