VIE, le grand souffle de François Richard
Livres Mauvaise Nouvelle https://www.mauvaisenouvelle.fr 600 300 https://www.mauvaisenouvelle.fr/img/logo.png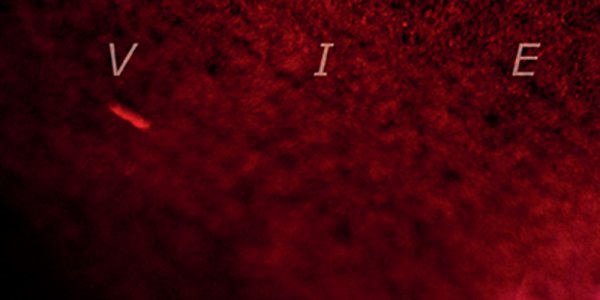
VIE, le grand souffle de François Richard
Voici qu’une discussion s’amorce par voie de littérature avec François Richard. Il s’agit d’une discussion où le mystère ne cesse de s’épaissir pour parvenir à nous comprendre. C’est en se reliant que nous tissons, c’est en écrivant qu’on se relie.
François Richard signe chez l’éditeur audacieux, Le Grand Souffle, L'asquatation, premier livre de VIE. Il y compte le récit de jeunes gens sortis de l’adolescence, réveillés amnésiques dans un squat de ruines et de vestiges par un homme bâti de récits et de langues qu’il est le dernier à connaître.
Plus d’info ici : http://www.legrandsouffle.com/site-edition/edition
Maximilien Friche : « Ivre d’incompréhension. » Voilà bien l’état dans lequel je me trouve en fin de lecture… et pourtant plein de choses se sont déposées en moi, plein d’autres flottent avec mes pensées. Votre narration est évocatrice, elle démultiplie les questionnements et élargit le champ du possible. Comment s’articule le hors champs narratif avec le hors champ de la conscience ?
François Richard : C’est le moment que j’attends de retrouver, c’est le kaïros tenu et suspendu que j’aspire à réintégrer, toutes les heures, chaque minute goutte à goutte, après que je me suis effondré hors du sommeil et que je dois foncer dans la vie hypnotisée jusqu’au soir, jusqu’à tard le soir. Le bord de la Terre dans le corps où l’on peut, appeler les chats dans la nuit et qu’ils viennent par dizaines, reprendre les derniers mots échangés avec des amis perdus, voir entrer les fantômes, les phénomènes et les miracles et soi avec. Une lisière qui est en soi et qui a maintes fois été mise en projections dans l’art -la zone du Stalker de Serguei Tarkovski, l’espace de coma de Alice de l’autre côté du miroir…- comme dans la science -connaissez-vous les expériences et la thèse de Jérémy Narby sur l’adn comme concentration akashique des images de la mémoire humaine, atteint dans une fréquence très fragile d’ondes cérébrales (à un point des tours où les ondes thêta ont la couleur des ondes gamma) qui font l’état de conscience océanique que l’on peut avoir dans les quelques secondes au sortir de certains rêves, dans l’hypnagogie ? et qui dans leur persistance impriment le syndrome d’Elpénor, cette sensation de conscience augmentée et de plénitude diffuse, que l’on approche lorsque l’on se lève à cinq heures du matin. Hé bien ce champ, ce sas aurique, c’est celui où l’art littéraire devient opératif. On n’en doute que lorsque l’on en sort, que quand on n’y est pas encore retourné assez pour hisser jusqu’au palais cette impression forte depuis les double-fonds de notre bagage épigénétique. Cela si vous voulez, c’est ma constitution depuis que j’ai vingt ans, lorsque tombé très bas j’ai percuté comme par de longs électrochocs assompteurs qu’un mot pouvait changer une vie, une bio, faire résonner comme dans le ventre de la baleine un corps devenu plus petit que lui dans un mugir très pur et puissant et infimement tenu, long… il est un pacte, un impacte, une façon de désormais-tracer dans le prisme cellulaire où nous sommes, résonner depuis lui que tout tient par un langage, dans les ombres et la structure-forte d’une parasémie. Semblable à une nuée fondée d’arches et d’arcs comme l’armature de très immenses bras séraphiques, tout de plumes carne et de gouttes.
Le hors champ du vécu sensoriel et le hors-champ de la conscience sont la même lagune et la captation de ses ombres et empreintes par leur littération mue rejoue le mythe de la caverne infiniment à l’espoir fou d’une fin, là où plus jeune leur manial (j’appelle manial un humain-manié-par-cette-anima) se tapait la tête contre les murs de l’hôpital psychiatrique, jusqu’à ce que l’aube de notre conscience advienne, un jour de basculement proche peut-être. L’arrivée du labyrinthe du monde comme du langage est la révélation et celle-ci est paradoxalement hors-langage, indicible, le seul moyen de la partager est de revenir emmener le monde, les autres, sur ses propres pas.
D’y revenir et d’y retourner comme pour plonger pour respirer, cela m’évoque le recours aux forêts, ou la forêt de Piel d’où il ne doit pas sortir et où il communique sans le savoir avec son soi futur, à l’aide d’un microphone, dans L’orphelin de Perdide, le lieu d’une discussion au plus profond de la nuit après les rêves dont parle Virgile Novarina… on y développe une assuétude dans la chair de l’esprit, sa cellulaire d’engrammes qui aspirent à tant de nourriture, et ce sentiment apodictique d’une réunion de soi, d’une Aliyah de ce qui est soi, et qui est la prescience universelle d’être dans l’imminence de chaque part de l’humanité, dans ce for. On en revient aube après aube avec la certitude de plus en plus constituante (une sertitude) de ce Nous solitaire (l’expression merveilleuse est de Philippe Boisnard) intrinsèquement voué à appeler ce Revoir, le Nous solvant. L’atteinte du nombre de dessillés, le seuil critique rêvé, le centième singe, où la bascule se ferait dans la conscience humaine vers un plan descellé et élargi. Être naturalisé revenant de chaque nuit dans cette intensité au cœur du labyrinthe du corps et que certains appellent le microcosme, fait prendre conscience des règles, de la loi hermétique quantique -l’aura est comme le nuage d’Oort qui ceint le système solaire, un homme est comme l’humanité entière, les rêves les plus aimants et féériques sont semblables aux météorologies magnétiques dans l’atmosphère, d’où s’influence considérablement l’humeur vitrée du traversé-fusionné par les parts, les corps mêmes.
S’aligner en conscience comme en rêve lucide tractile, se confondre, se synchroniser à cette envergure qui est soi et nous tous. Il est possible de faire un cyclone de cet anneau. Dans cet espace foré il y a l’aspiration qui est à une royauté cachée, peut-être en exil. C’est dans la zone, dans l’état flottant et agrandi que j’évoquais, que cet état devient être. Être, Royauté et œil de cyclone sur le même plan de réel simultané, synchronisé. Un homme qui déciderait de faire revenir cette orée, de l’attirer à son corps entière, de ferrer la nuée de toute notre humanité singulière, un homme qui déciderait de conscientiser aussi loin qu’il le peut cette lisière en un couronnement, en deviendrait le roi ordonnateur secret.
A mon sens entre tous l’art littéraire est celui qui permettra d’approcher au plus près cet état analogue à même, et par tous, parce qu’il travaille directement sur le double fond de tout le langage (en réalité l’orbite terrestre est basse, dedans, phréatique) et parce qu’il concentre en son encre et ses ombres potentiellement tous les autres mediums. Mais il est aussi le plus rare à atteindre cette fusion absolue intermittente, ce kaïros de passe même en plein jour parfois et où l’on voudrait rester, parce qu’il est paradoxalement en apparence le plus accessible et le plus facile.
Je vis lorsque je suis impacté par la lecture de tels passages. Il y a des textes vaudou qui vous y emmènent. Ils sont quelques-uns mais tellement rares dans la littérature, qu’on ne les mentionne pas par auteur, ni même par livre, mais par pages. La fin de Méridien de sang de Cormac Mc Carthy, le début de 1993 de Mehdi Belhaj Kacem, le Mus de Maurice Regnaut, les acmés de Lauve le pur de Richard Millet par exemple. Le conte atteint le contage, attise une lueur intra l’adn, dans toute la salle terrestre, une pensée qui vient s’articuler, sous toutes les langues.
MF : « Il veut provoquer remuer à l’intérieur des gens des strates phréatiques pour déclencher des éruptions en chaîne. » Vous nous donnez accès au verbatim intérieur des personnages et c’est ce qui est troublant. Est-ce par la lecture du jargon intime que la religation des personnages s’opèrent entre eux ?
FR : il apparaît évident, presque trop, que cette langue étrange commune est celle dans laquelle ils se sont tous réveillés, au sortir d’une enfance et d’une adolescence dont ils n’ont aucun souvenir, et que cette onde qui agit leur langage et leur pensée pourrait les indifférencier. On pourrait aussi noter qu’elle est étrangement proche de la langue de l’aède qui dit le récit et dont on ne sait rien pour l’instant… mais j’ai jeté douze dés à douze faces et je n’ai eu que des chiffres différents. Comme la capacité du rock n’roll à se renouveler avec les mêmes douze accords, la nature mediumnique et magique de l’écriture me surprendra toujours, à emmener vers elle l’intension qui y tend. Dans le tracé de ces figures, à travers cette voix Leur semblable, j’ai bien vu apparaître douze jeunes gens très différents par-delà les résonances ressemblantes de leur voix intérieure et ce n’est pas le moindre miracle de la créativité qui est entrée en jeu dans l’édification.
MF : L’enjeu est-il de se comprendre au-delà des intentions, malgré les intentions, en l’absence d’intentions ? Qui suis-je ? La question se promène tout au long du roman. Il semble même que le lecteur soit muté en énigme lui-même au regard de la réponse que constitue le roman…
FR : merci pour cette merveilleuse formulation. C’est le vertige psychique, métabolique et métaphysique que j’évoquais, celui dont à mon sens l’art littéraire en tant qu’art du langage (ce que ne seront jamais l’éloquence ni la communication…) a la charge, à travers toutes les langues du monde. Vous dévoilez presque la toute fin des cinq livres mais c’est un soupir de réjouissance. La fin de Cité de verre de Paul Auster est un coup de maître dans la mise en abyme vertigineuse, mais cette fin et ce vertige ne forment alliage -et résonance concrète, affolante, dangereuse- que par leur circuit d’enchevêtrements cachés tout le livre. Lequel reflète peut-être bien, par son intensité dans la bio, un plus haut tressage, le film que nous traversons par lui serait la toison des Argonautes vers la fresque, qui justifierait tout l’univers par sa beauté et le syndrome de Stendahl cliqueteur qui l’en dissoudrait. Ou la maille chaque fois recommencée de Pénélope, qui ne saura qu’à la toute fin l’épopée qui s’est passée derrière, de l’autre côté du temps gagné qu’elle tissait. Je parle bien d’une réponse à toute l’humanité au bout de l’ouvrage qui, d’elle, sacrera l’art littéraire. « en l’absence d’intentions », toute la question métaphysique est là, un art est répliquant.
La seule comparaison que je trouve, dans le monde projeté et dans ma propre expérience avant de connaître l’art littéraire, et c’est une situation-type (je l’ai eue plusieurs fois), c’est l’homme en fin de parcours rencontré au bout de la nuit au comptoir d’un café déserté il y a peu de ses derniers clients solitaires avant la fermeture de la nuit, chaleureux mais un peu sombre, et là un dialogue lent, espacé, mémorable, ou immémorial, peut commencer. Je pense au texte de Léo Ferré, « Les hommes, il conviendrait de ne les connaître que disponibles, à certaines heures pâles de la nuit… ». L’écriture au plein sens de ce qu’elle est à faire ici, est de climatiser en quelques mots, et pour les imprimer longtemps jusqu’à les faire émerger, cette disponibilité et cette nuit, vers la fin.
MF : « Est-ce que vous racontez les jours ? ou est-ce que vous comptez les jours ? » Vous semblez convoquer l’au-delà pour vaincre le temps. C’est l’ennemi caché le temps ? Un faux ennemi ? « Hier est un projet. C’est le corps vainqueur qui modifiera tout le temps rétroactivement. »
FR : Cette ritournelle avec les deux phrases superposées qui se confondent à une syllabe près, c’est une boucle radio entendue très tard dans l’émission Polycarpe sur Radio Béton à Tours, au milieu des années 90. Les fonds sonores s’enchainaient derrière, à la fois bruitistes et oniriques. C’était là de véritables expériences sensorielles, et une formation pour la sensibilité, comme certaines Nuits magnétiques la même époque sur France Culture, mais en plus sali, hanté, émouvant. Des initiations dans ma matière, qui m’ont acclimaté au texte -le texte comme temps extérieur au temps extérieur, à l’intérieur, comme a pu l’écrire Valère Novarina. Bien. Le temps est mon maître et écrire est le faire regagner peu à peu nos rives. Ce n’est pas moi qui ai formulé aussi clairement cette vocation et cet ultimatum, mais un homme avec qui je les partage, Nathanaël Flamant, auteur et éditeur du Grand Souffle. Il faut savoir qu’il a écrit l’un des plus beaux sonnets de la langue française et que personne ne le sait pour l’instant. Il écrit comme un homme brûle. Je me sens proche de sa blessure impansable portée depuis la toute-enfance. Le temps est mon maître et un très grand nombre d’indices m’incitent à penser qu’il en est de même pour tous, que temps et corps sont les deux seuls termes à porter la même finalité, que le second est l’extrémité freinée et freinante du premier. Peut-être que le corps est le souci du temps pour se déployer. Christian Prigent a dit qu’il n’écrirait pas si ce n’était pas le moyen pour lui de gagner du temps. Il est lucide et pudique, il préfère ne pas être taxé d’allusion à une transcendance. Je le doublerai sur la ligne blanche en murmurant que vivre dans la trace des ombres du temps est la voie de le faire gagner sa prochaine mue, et qu’il s’agit d’empuissanter ce temps en sa vitesse de libération intrinsèque même, vers sa prochaine mue, fort d’avoir traversé notre stade. En l’état, nous me faisons penser à cette série avec les Hubots les robots semblables aux humains conçus pour être leurs serviteurs de foyer, et qui ont un circuit de bride, le code Asimov, pour ne pas accéder à des facultés de raisonnements en conscience élargie. Et en qui le code dévoilé les rendra plus humains que les humains, d’une façon inimaginable pour eux. C’est étrange de faire mine d’en disserter tant c’est l’évidence dans mon processus d’« inhaussement » (terme que je trouve plus juste qu’ « exhaussement ») des années de jeunesse et de maladie, à maintenant. Il y a longtemps, je toisais sa muraille inaccessible, loin de mon corps mort, comme transi devant la cascade derrière laquelle il y aurait le temple inca, sans nous solutionner mais m’emplissant de tant d’ombres que c’était ma chair comme autant de hurlement lacérants du silence du temps. Je ne sais plus quel poète a dit qu’il fallait faire un bond plus rapide que le désastre. J’ai refait un pas dans mon corps en comprenant que c’était le seul moyen de traverser la mort et de faire passer le temps par ses ombres. Quand tu as seize ans et demi et que tu connectes que les trois quarts des tiens sont soit pauvres, soit en guerre, soit en train de crever, et que tu n’as que des ahuris béats autour, le tout dans une apparition incompréhensible (le monde n’a aucune chance d’être apparu par hasard) et aux abords très perverse (ton espèce a besoin de détruire la nature, de se détruire, elle est faillible en tout), tu comprends que tu es dans un jeu tordu avec tous les autres amnésiques, amputés du souvenir de pourquoi nous sommes là à tout détruire pour tes enfants et les autres règnes, un jeu auquel la conscience et la raison en toi t’interdisent de participer, la seule chose qui agrippe c’est ces instants de réponse à tout, les fulgurations de la beauté, la découverte qu’il y a aussi dans les besoins primaires une soif spirituelle, enfouie mais pas tant que cela. J’en ai eu besoin tôt, même dans les périodes où j’avais faim et soif. Et le pressentiment qu’il y avait là un appel, qu’il y avait un lien entre la réalité supérieure de l’esprit et de la beauté, et cette mémoire occultée de l’origine en nous-mêmes du flot de notre apparition (origine d’où le temps chercherait à jaillir à travers nous, que l’on pourrait donc paradoxalement appeler une « arrivée de temps »), c’est l’extrêmement mince sentier qui permette de passer. Et là commencent les phénomènes, les miracles, les signes. Le sens, une promesse tacite. Mais cela ne t’innocentera que si tu vas te confondre à la vérité qui t’attend tout au bout, au bout de toute la chaîne de vivants qui sont morts pour que quelqu’un d’entre nous y parvienne et cliquète pour tous ce code Asimov. Sinon écrire n’aura été qu’une sale manie humaine de plus, pour paraphraser Georges Brassens. Ecrire c’est bien une route, avec un premier pas et il y a une arrivée. Lianes d’une ruée pour poser le prochain pas sur l’étant. Vers la fin, avant Ithaque il y aura la mer. Et voilà. La route, tout cela aura eu un début, et une fin. Le peintre sait le moment où sa toile est finie. A un stade de son temps, il sent aussi que cela sera sa dernière toile, qu’il a atteint la vérité qu’il cherchait en lui. Il ira s’allonger pas très loin de ses toiles, et il retrouvera tous ceux qui étaient dans la nuée de son sang.
MF : « Elle cherche à savoir si ce monde est vrai. » Les jeunes gens que vous présentez dans votre roman se réveillent dans squat, un lieu de ruines, ils sont amnésiques. Ils semblent se poser les questions : comment en est-on arrivé là ? Que voulons nous retrouver ? Et avec votre narration on sent le retour possible des temps mythologiques, de la « légende songée. » et l’abstraction possible de l’époque positiviste et matérialiste. Vous posez la question de la volonté. Le stade dans lequel l’humanité se trouve est-il plutôt fausse route que maturité ? Tout ce qui nous entoure n’est-il que ruines ? Il s’agirait de rebâtir quoi avec quoi ? Vous écrivez : « Une civilisation où la magie serait maintenant cachée ne pourrait vivre que cachée, ne peut être autrement que cachée. » …
FR : Merci à nouveau pour votre lecture, et pour ces niveaux de lecture. Mais c’est beau, les ruines. Ce sont elles qui sont cachées, au-delà du squat. Elles respirent et émanent une vérité bien supérieure à celle des enduits. La même que celle qui phosphore des gisants, ou des trônes au milieu des forêts au Japon. Un peu comme si elles précédaient tout, même le règne végétal, dans leur hiératisme. Je vous enjoins à découvrir celles de Jean-Marc Dauvergne sur sa page. Les ruines rejoignent les plus profondes musiques, leur translation dans les sphères sonores de l’onde.
Ce faisant, les rejoignant comme dans un processus de migration, elles reviendront aspersion sur le gel du temps, par le diaphragme, les tempes, la rate, de ce convoi, de haute matière cristallisée.
MF : « O notre âme, c’est un bateau. » La question de l’arche est au cœur de l’aventure de ces jeunes gens. Savoir saisir les épiphanies nous fait-il monter dans l’arche ? En lisant VIE, j’ai pensé à l’écrivain Andréï Makine qui parle de l’Alternaissance, comme la possibilité à la fois de dépasser sa naissance biologique et de se dépouiller de sa naissance sociale. Vous-même vous écrivez : « Des jeunes gens naissaient pour la seconde fois. » Quel rapport établissez-vous dans votre roman entre l’arche et le fait de renaître ? VIE, c’est le retour des morts ?
FR : Exactement (par contre le néologisme d’André Makine a été forgé par un boucher). La mandorle du for irréductible comme l’arrivée de mort, des morts. Ce qui est vertigineux, est l’envergure de la matière absorbée et aurifiée de cette nuée qui revient, la transmutation de l’effroi en émoi, elle qui impacte la matière de la vie jusqu’à de très vastes cercles au loin, dans une contraction-expansion de soi qui fait de sa persona la figure du Corroyeur de Alain Damasio dans La horde du contrevent, et ce entièrement secrète, inaperçue -volcanisant de ses auras pendant les repas, les trajets en tramway, les travaux de journée pour pouvoir manger le soir. La toison fantôme se déploie et mine les alcôves de l’air, de soi à nous. Mille angéiographies, mille vaisseaux de son reflet dans l’adn parmi l’air comme parmi notre sang.
Cette diaspora de matière atomisée et monades garde la nature de la plénitude initiale dont elle est le tissu, le Cercle, dont l’arche, l’anneau d’alliance font partie de la galaxie analogique, avec de merveilleuses associations dans les récits du Livre, qui ancrent les archétypes de nos profondeurs. Regardez les danseurs de Carolyn Carlson, le Edward Lock, synchronisés dans une vitesse irréelle de part et d’autre de leur centre de gravité, « il vous faudra tourner longtemps pour appréhender ce qu’est le Cercle. Et un jour vous vous apercevrez que votre espace est devenu dynamique, puissant, et qu’il vous faut maîtriser cette force ». Le for est cette force, l’accès de la crypte et le sanctuaire, le microcosme. J’avais écrit un morceau dont le titre, The arc, est sous-titré Sentier, pour la proximité avec « sentir » et la prononciation de « centre » en anglais. Le premier pas dans cette émission de temps venu de la passagerie, c’est sentir par ses poumons l’arrivée du deuxième souffle dont parle le Hors-Humain. « Les deux moments les plus importants sont celui où vous êtes né, et celui où vous avez compris pourquoi », Mark Twain.
MF : « Seul le noir le plus noir absorbe toute la lumière et permettrait un jour nu de voir au travers le Roi en son miroir. » On parle de légende songée, on navigue et on découvre le pays qui est en nous. Y-a-t-il dans votre roman une invitation à traverser le miroir ? Est-ce l’enfant que nous fumes vous voulez réveiller ? Est-ce nos rêves qu’il faudrait rendre performants ?
FR : « Il nous faut de l’aide, décida le poète » (je vous laisse chercher d’où vient celle-ci). Nous sommes allés chercher nos rêves et nos idées tout au fond du noir, c’est-à-dire que nous avons trouvé nos armes là où une voix nous a dit d’aller les chercher. Nous les avons insurgées et cette florescence quantique depuis fait lentement son travail dans l’esprit de ceux chez qui ces rêves et ces idées étaient déjà en graines, en ferments dans les fonds non drainés de leur psychisme, où qu’ils soient, quand soient-ils. A présent il y a à empuissanter ces songes qui sont les nôtres. Il y a à insister. Le second assaut, inouï, se profile à l’horizon de la forteresse du désert des Tartares.
MF : « Je suis venu chanter ma chanson. » La question de la langue est au cœur de votre roman. Vous faites également un usage totalement nouveau de cette langue et cet usage devient fractale du roman, la forme est une fractale. Toute langue véritable est-elle appelée à devenir chant, musique ? « On lisait des poèmes jusqu’au chant intérieur. Dans toutes les langues. » C’est une symphonie en trois mouvements que vous avez composée ? « La guerre poétique finale fonde la langue immortelle renée. » Cette langue immortelle n’est-elle pas que non-dits mis en musique ?
FR : elle est dans l’indicible compris de certaines associations phonaires et sémantiques, s’approchant peut-être de la langue transmentale de Khlebnikov, elle résonne au plus haut sens en soi, au diaphragme où l’impact de l’intelligible rejoint la sensation. Elle est le moment pur où sur scène le poète vient de dire ses derniers mots et saisit sa guitare, pour laisser toutes les notes venir sacrer l’espace de résonance de ses mots, et les rejoindre. L’instant où entre toutes les versions perdues le corps du monde est sauf. Pour une destination de nymphe.




