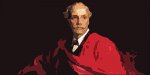Jacques Dewitte : Un parti pris de l’excellence
Monde Mauvaise Nouvelle https://www.mauvaisenouvelle.fr 600 300 https://www.mauvaisenouvelle.fr/img/logo.png
Jacques Dewitte : Un parti pris de l’excellence
Jacques Dewitte est philosophe. Traducteur de Leszek Kolakowski, d’Adolf Portmann, mais aussi de Robert Spaemann et d’Hannah Arendt, il est l’auteur d’ouvrages remarqués dont Le pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit (Michalon, 2007), L’exception européenne (Michalon, 2008) ou encore La manifestation de soi (La découverte, 2010). A travers le premier, il s’en prend au danger totalitaire qui menace notre parler, dans le second, il défend un patriotisme philosophique en faveur de l’Occident. Dans son dernier ouvrage, La texture des choses (Salvator, 2024),il met en avant le geste ontologique majeur de l’Europe gréco-romaine et judéo-chrétienne : la défense des formes différenciées. Pour Mauvaise Nouvelle, il revient sur quelques thèses majeures de son livre.
1- La Texture des choses s’ouvre sur la défense du geste spécifiquement occidental « en faveur des formes différenciées ». Pourriez-vous définir ce dernier et nous dire en quoi il s’oppose à d’autres paradigmes ?
Une remarque terminologique : « paradigme » est un concept que j’écarte, et « geste » me semble très pauvre. Je parle ici d’un « choix originaire » ou d’un « parti pris ». Il y a plusieurs « choix » ou « parti pris » possibles, qui peuvent avoir leur légitimité, même si le parti pris de l’excellence, le parti pris en faveur des formes différenciées me paraît supérieur et si j’ai pu avancer qu’il était spécifiquement occidental et constituait ce qu’il y a de meilleur dans notre culture. Mais je considère aussi qu’il est impossible de « démontrer » cette supériorité.
Quel est le parti pris opposé ? On en trouve plusieurs exemples au cours de l’histoire. Il y a celui que défend Antiphon, et que rejette Aristote dans le chapitre de la Physique que je commente : un choix pour la matière indifférenciée. Il y a aussi l’atomisme, qui fait préférer des unités invisibles aux formes visibles. Mais dans le Banquet de Platon, comme l’a remarqué Allan Bloom, Diotime « donne la première place aux espèces visibles. (…) Elle n’est pas atomiste. (…) Cela reflète un changement dans l’ontologie ou la compréhension de la nature, qui est historiquement lié à la démarche de Socrate, celui-ci s’étant détourné de l’effort pour voir les atomes – effort pour voir qui aveugle – au profit de la considération des formes diverses des choses. »
A l’époque actuelle, il y a l’évolutionnisme dans toutes ses variantes, cette conception très répandue dans laquelle, si on suit sa logique propre, « il n’existe pas de chose telle qu’une chose. Tout au plus existe-t-il cette chose unique : un flux de tout et de n’importe quoi.» (Chesterton)
Toutefois, mon parti pris pour les formes différenciées ne m’empêche pas d’admettre que d’autres auteurs, et notamment des artistes, aient pu défendre un parti pris opposé, en privilégiant un autre aspect de la réalité. Ainsi, Jean Dubuffet lorsqu’il écrit : « L’univers est continu et procède en tout point de la même farine », privilégiant donc un continuum contre les formes distinctes, lesquelles, à ses yeux, sont censées être artificielles et seraient donc à défaire comme autant de produits d’une « asphyxiante culture » (titre d’un de ses livres). Je rejette catégoriquement cette ontologie tout en admettant qu’elle a pu donner lieu à une œuvre qui donne à voir un pullulement originel duquel se détachent parfois, en un surgissement, certaines formes reconnaissables.
Il n’est du reste nullement sûr que les auteurs que je mets en évidence comme représentant un « geste typiquement occidental » soient plus nombreux que ceux qui soutiennent le parti pris opposé.
2-D’après vous, ce goût pour la diversité déclinerait, notamment dans le domaine de l’architecture. Quelle est cette « typologie » défendue par Léon Krier et que peut-elle apporter à notre époque d’uniformisation généralisée ?
Le point de départ de cette réflexion est la constatation d’une perte. Dans Forme et caractère de la ville allemande, son bel ouvrage que j’ai traduit, Karl Gruber met en évidence une dimension présente dans la ville ancienne qui a quasiment disparu dans la ville modern : les divers bâtiments étaient distincts et reconnaissables par leur forme extérieure. Il existait une différence visible entre les édifices sacrés et les édifices profanes, et une différence existait aussi entre différents types d’église, à l’intérieur d’une hiérarchie. De même pour les édifices profanes : l’hôtel de ville se distinguait des simples maisons bourgeoises ou ouvrières, et celles-ci se distinguaient entre elles. Ce qui se existe à l’intérieur de la ville se manifeste également dans la « silhouette de la ville », dans son apparence globale : le voyageur approchant de la ville pouvait distinguer de loin ces différents types de bâtiments.
C’est ce que l’on appelle une « typologie » : un ensemble de « types de bâtiments » reconnaissables pour ce qu’ils sont. Les bâtiments sont construits d’après un certain « type » (ce qui ne doit pas être compris comme un modèle rigide).
Bien sûr, cette différenciation allait de pair avec une hiérarchie, qui était elle-même non pas sommaire et grossière, mais très diversifiée. Or, notre compréhension moderne se veut égalitaire et égalitariste, elle récuse par principe toute hiérarchie et toute verticalité. Rien d’étonnant à ce que cela se traduise par une indifférenciation du bâti.
Mais il y a aussi un autre aspect : dans la situation moderne, « on » (les individus, les bâtiments) cherche aussi à se rendre « différent », « intéressant », « génial », en une incessante surenchère qui aboutit en fait au résultat inverse : tout se ressemble.
Léon Krier, a prolongé cette inspiration, principalement dans ses dessins didactiques et humoristiques, en opposant la situation traditionnelle, où les bâtiments sont clairement reconnaissables, à la situation moderne où un même profil est attribué à différents bâtiments. Il en va de même pour les objets quotidiens qui, dans un certain design, tendent à perdre leur spécificité visible.
Vous demandez : qu’est-ce que cette mise en évidence de la typologie peut « apporter à notre époque d’uniformisation généralisée » ? Pas grand-chose, je le crains. A tout le moins, une conscience de ce que l’on a perdu. Et peut-être l’amorce d’une forme de « conversion » qui peut consister à admettre que l’on peut s’inscrire sans déchoir dans un ensemble de formes reconnaissables.
3- Il existe, selon vos dires, un « patrimoine toponymique » : contre la géographie isotrope et homogène de notre temps, un ensemble de termes riches serait susceptible de décrire une montagne par exemple. Pourriez-vous revenir sur cet héritage lexical en péril ?
Vous relevez un thème de mon livre, illustré par une citation d’Henri Raynal et un page du vieux Larousse illustré, qui est exposé très brièvement (pp. 38-40) et qui mérite un approfondissement. Première remarque : ce n’est pas seulement un problème « lexical », même si, de manière globale, notre « héritage lexical » est en effet « en péril ». Il y a d’abord une capacité à discerner les différences et les nuances qui sont « dans les choses » et, en l’occurrence, dans le relief géographique ; des mots ont été inventés pour désigner ces nuances. C’est parce que l’on est capable de distinguer, parmi les diverses avancées de la terre dans la mer, un « cap » d’une « péninsule » (pour paraphraser Cyrano) que l’on a forgé ces deux mots et bien d’autres encore. (Car dans toute ma pensée, je ne pose jamais ni « les choses », ni « les mots » comme absolument premiers. Même si je soutiens une conception « réaliste », elle ne revient pas à ignorer l’importance des concepts et du langage.)
On peut penser que c’est la fréquentation d’un certain domaine de réalité : la côte, la montagne, qui a peu à peu amené les hommes à forger un lexique toponymique riche et différencié, correspondant à la diversité des phénomènes rencontrés. Ce lexique, un fois forgé, permet de donner forme à la diversité de ses perceptions. Car faute d’un lexique, d’une langue riche, c’est aussi la capacité perceptive qui tend à s’étioler ; on perçoit moins bien lorsqu’on ne dispose que d’un lexique appauvri.
On a affaire ici, à travers cet exemple limité, au rapport entre la LANGUE (l’ensemble des ressources lexicales, mais aussi grammaticales dont on dispose) et la PAROLE (qu’on peut appeler aussi DISCOURS), comme effort pour « dire » quelque chose et, par exemple, pour nommer ce que l’on voit.
4- Avec l’esprit moderne est advenu le goût pour le nominalisme : selon cette perspective, une chose existe dans la mesure où elle est nommée, et non pas « en soi », comme le suggèrent les réalistes. Au moment où Hermogène triomphe, comment défendre Cratyle ?
Une première remarque : mon approche de la réalité en général et de l’histoire de l’Occident est de plus en plus « ontologique ». Je crois que c’est à ce niveau que les questions fondamentales apparaissent le plus clairement et que l’on peut saisir au mieux « la texture des choses ».
Le « nominalisme », doctrine apparue vers la fin du Moyen-Âge, qui est décisive dans la « querelle des universaux » me paraît constituer en effet un fil conducteur de l’esprit moderne. Les mots ou les concepts généraux ne seraient « que des noms », sans avoir de teneur ontologique (par opposition à ce que soutient le « réalisme »). La seule réalité véritable, ce seraient les individus. Le nominalisme va de pair avec un « constructivisme » que je combats également : l’idée que l’esprit (ou les actes) construirait librement une matière première supposée être « indifférenciée » et supposée ne pas avoir de « visage ».
De même, pour le nominalisme, les institutions (autre modalité des universaux) sont censées ne pas avoir de teneur ontologique. J’ai lu quelque part que le Franciscain Guillaume d’Ockham, fondateur du nominalisme, aurait déclaré un jour que l’ordre franciscain n’existait pas, car seuls avaient une existence les moines franciscains, c’est-à-dire les individus. De sorte que – je ne sais pas si cela a déjà été remarqué – le nominalisme va de pair avec l’individualisme, cet autre trait majeur à la fois social et ontologique de la modernité, qui a pris une importance considérable aujourd’hui et contribue au délitement de nos sociétés. Nous sommes à la fois nominalistes et individualistes.
Vous me demandez : y a-t-il moyen de « défendre Cratyle » contre «le triomphe d’Hermogène » ? Ma réponse est qu’on peut y contribuer en s’efforçant de penser autrement. C’est dans cet esprit que je critique la notion de « découpage », omniprésente en philosophie et dans les sciences humaines (chaque culture « découperait » autrement le donné naturel) qui implique une approche constructiviste et nominaliste (voir mon article « Découpage et convenance » paru dans La Revue du MAUSS). Si on s’efforce de renoncer au concept de « découpage », en tentant d’envisager la réalité différemment, en reconnaissant qu’elle a une structuration propre, notamment en introduisant la notion de « convenance », il est permis de penser que l’on œuvre - modestement - à une mise à distance d’Hermogène.
5- Nous connaissons votre vif intérêt pour l’œuvre d’Hannah Arendt : contre le fonctionnalisme sociologique, cette dernière défendait l’art subtil d’établir des distinctions. Quelle est cette « cacheroute épistémologique » issue du judaïsme dont la politologue serait tributaire ?
On appelle « cacheroute » (qu’il faudrait écrire « cacherout ») l’ensemble des prescriptions alimentaires dites « cacher » auxquelles les Juifs orthodoxes doivent se soumettre et qui consiste principalement en différentes séparations : la plus connue est qu’il faut tenir à l’écart le lait et la chair de la chèvre. En outre, on considère souvent que le récit de la Création, dans la Thora, consiste en une série d’actes de séparation à partir d’une confusion originelle.
Dans ma lecture de Hannah Arendt, j’ai montré qu’existait chez elle une évidente « passion des distinctions » (la religion et l’idéologie, le pouvoir et la violence, sont des phénomènes distincts). Dans le fil de ma réflexion, j’ai rapproché cette attitude de celle de Leo Strauss, qui a mis en avant le principe appelé « hétérogénéité noétique », qui consiste également à discerner les différences essentielles entre les choses. Et j’ai songé aussi à un passage étonnant qui se trouve au tout début du premier volume des Recherches logiques de Edmund Husserl, où celui-ci met en garde avec véhémence contre la « confusion des domaines, le mélange de choses hétérogènes » en matière scientifique. Et j’ai été amené à me dire : ces penseurs étaient tous trois des Juifs, un Juif pieux et orthodoxe dans le cas de Strauss, un Juif converti au protestantisme dans le cas de Husserl, mais ne pourrait-on pas se risquer à avancer que cette exigence fondamentale du judaïsme : ne pas confondre ce que l’on doit tenir séparé, les aurait marqués à leur insu, même dans des domaines extérieurs aux prescriptions alimentaires ? C’est ce qui m’a conduit à cette trouvaille d’écriture : il y aurait là quelque chose comme une « cacheroute épistémologique », une cacheroute qui serait à l’œuvre à l’intérieur même de l’activité de connaître.
6- La dernière partie de votre livre porte sur les thèses ambitieuses du zoologue Adolf Portmann (La forme animale, 1961). En quoi celles-ci s’opposent-elles à l’utilitarisme moderne pour qui le vivant se limite à la conservation de soi ?
Portmann est un auteur d’une importance considérable que je m’efforce de faire connaître depuis longtemps (voir ma traduction révisée de La Forme animale et plusieurs chapitres de mon livre La Manifestation de soi ; d’autres livres sont en préparation). Il effectue à la fois un travail descriptif (par des dessins et des commentaires) et un travail argumentatif consistant à montrer les limites des théories les plus courantes, d’inspiration darwinienne. Il montre ainsi que la notion de « valeur sélective », à l’encontre de sa prétention, est incapable de rendre compte de l’apparition des formes animales dans leur richesse et leur singularité. Pour tenter d’en rendre compte, il introduit d’autres concepts : « apparence » « apparence véritable » et surtout « autoprésentation » (Selbstdarstellung). De manière en partie énigmatique, il y aurait, inhérente au vivant, quelque chose comme une exigence de « se montrer pour ce qu’on est ». Il y aurait donc dans la vie un chevauchement entre plusieurs finalités : celle de la conservation de soi, qui demeure présente, s’entrecroise avec celle de l’auto-présentation D’un point de vue utilitariste, une bonne partie des formes animales apparaît comme purement gratuite, mais cela ne signifie pas qu’elles seraient dépourvues de toute finalité.
7- Les systématiciens des sciences naturelles ont la fâcheuse tendance de confondre plusieurs caractéristiques des êtres vivants au sein de catégories homogènes. Qu’est-ce que le « tact systématique » évoqué par Darwin et comment ce dernier peut nous aider à mieux discriminer une réalité zoologique déjà échelonnée ?
« Tact systématique » est une formule de Darwin citée par Portmann que je n’ai pas pu retrouver, et qui n’est pas facile à comprendre. Elle semble signifier que les bons « systématiciens » (on appelle ainsi ces zoologues qui entreprennent une classification des espèces, une « taxonomie ») ne s’emparent pas de n’importe quel trait, mais savent discerner et choisir, avec une sorte de finesse, les traits qui permettent de distinguer les espèces entre elles.
Mais dans ce livre et dans d’autres écrits, je donne une portée plus générale à cette notion de tact. C’est une forme de « tact » qui nous permet, dans l’usage courant du langage, de ne pas parler de la même façon selon la personne à qui on a affaire (à un enfant, à une personne de son âge, à une personne âgée). Il me semble que c’est aussi une forme de « tact » qui caractérise l’attitude requise d’un scientifique consistant à savoir à quel type d’objet il a affaire et à comprendre quelle est la méthode qui lui convient. Aristote écrit que c’est faire preuve d’un « manque d’éducation » (apaideusia) que de ne pas savoir distinguer entre les choses qui appellent une démonstration et celles qui excluent une telle démarche. Ce « manque d’éducation », c’est très précisément un « manque de tact ».

Photo : La création des animaux, Le Tintoret