Lire le Grand Meaulnes et s’en souvenir
Livres Mauvaise Nouvelle https://www.mauvaisenouvelle.fr 600 300 https://www.mauvaisenouvelle.fr/img/logo.png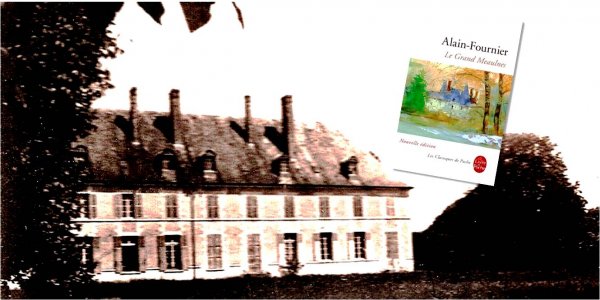
Lire le Grand Meaulnes et s’en souvenir
Quelle joie d’être ici, à Cluis, dans ce lieu qui est à la fois centre et marge. Centre d’un territoire, centre d’une narration, et en marge des sphères germanopratines. Et quelle joie d’être au centre de cette marge pour causer du Grand Meaulnes, moi qui suis un lecteur lambda -c’est dire si ma lecture est importante- parce que je n’ai lu le livre que tout le monde a lu uniquement depuis août dernier. Je me revendique donc vierge d’une certaine maturation sur le récit tout comme des nombreuses gloses dont il fut l’objet depuis les collèges de la République jusqu’aux salons où l’on cause sans s’écouter. Ma lecture du Grand Meaulnes est une lecture « neuve », vierge d’apriori, de commentaires de l’œuvre, et surtout vierge de souvenirs. Je m’en voulais un peu lorsque Murielle Lucie Clément me suggéra la participation à ce colloque de ne pas avoir lu ce livre phare, mais je me souvins aussitôt que Jean d’Ormesson n’avait découvert don Quichotte qu’après ses 70 ans. Et j’ai donc cherché, dans mon regard sur l’œuvre, à cultiver ma virginité. En lisant le roman sans en lire la préface, sans en lire la page Wikipédia, sans en lire d’autres commentaires, sans même lire la biographie de l’auteur. Je voulais lire cette histoire, l’apprécier pour ce qu’elle raconte et pour comment elle se raconte.
Lorsque je me suis mis à lire le Grand Meaulnes, durant mes vacances en famille dans le Gers, j’ai interrogé tout être vivant passant à mes côtés sur le roman. Avez-vous lu le Grand Meaulnes ? Aviez-vous aimé ? Qu’en avez-vous retenu ? Et la succession des réponses eut pu me plonger dans une profonde aboulie si je n’avais pas entrepris en parallèle de me faire une idée moi-même sur ce roman. Certains se souvenaient l’avoir lu ou partiellement étudié au collège mais étaient incapables de me dire quoi que ce soit de l’œuvre, même pas de me citer le nom des héros. Pire, un bon nombre ne se souvenaient pas si ils l’avaient lu ou pas, confondaient avec d’autres, n’étaient plus sûrs… D’autres encore semblaient faire une moue évoquant de mauvais souvenirs impossibles à transformer en commentaires. Enfin, il y eut mon beau-frère qui sortit l’adjectif : « onirique ». Puis mon beau-père me dit, « Ah oui, on était tous amoureux d’Yvonne de Galais. » Je partis donc à l’étude d’un des plus grands chefs-d’œuvre littéraires français du XXIème siècle, l’un des livres les plus étudiés et enseignés, avec un vide inspirant la plus grande désolation. Je décidai donc de partir à la conquête du roman en intitulant mon propos : Lire le grand Meaulnes et s’en souvenir. Pourquoi s’en souvenir ? C’est ce que nous allons voir ensemble.
Mes débuts en lecture furent hésitants. Avais-je à faire à un Marcel Pagnol du Berry et de la Sologne ? Avais-je à faire avec un récit de l’enfance, petit livre fabriqué et flatteur pour le lectorat comme le furent les mots de Jean-Paul Sartre ? Non, ce n’était pas ça. Il y avait là, sous mes yeux, une trame, un texte qui se tissait comme un piège, une résille pour les héros, pour le narrateur, pour l’écrivain et pour le lecteur.
J’ai opté pour une méthode dont je ne sais si elle est académique ou non. J’ai fait émerger de ce texte des thèmes où il me semble que l’œuvre révèle sa force. Et j’ai tenté d’observer comment, au travers de chacun de ces thèmes, on pouvait observer une convergence pour qualifier l’œuvre de tentative de retour à la tragédie arthurienne, venant heurter une tendance à l’horizontalité de la littérature de l’époque et d’aujourd’hui. C’est mon intuition. Les thèmes sont ordonnés suivant ce que la lecture m’a suggéré, et non suivant une importance ou une lecture structurée particulière.
Nous traiterons d’abord en prenant notre temps deux thèmes : Entre silence, bruits et voix off et, l’aventure et la narration. Nous traiterons après de façon plus concise deux autres thèmes : le monde banal et le monde extraordinaire ; l’enfant héroïque et l’adulte citoyen. Et nous verrons ensemble si les éléments retenus nous permettent de converger vers mon intuition.
I Entre silence, bruits et voix off
Le premier thème qui me saute aux yeux avec ce roman, c’est le rapport au silence et aux bruits. Les deux ne s’opposant pas mais formant un décor, environnement dirait-on aujourd’hui. Alain-Fournier utilise quasiment autant les bruits que les images pour camper le décor. Même l’absence de bruit dessine en creux le paysage. « Pas même le cri d’un courlis dans les roseaux des marais » (Le Livre de Poche - ISBN 978-2-253-08264-4 - p101). Ou encore « Un silence parfait régnait sur ce domaine. Par instant seulement on entendait gémir le grand vent de décembre. » (ibid p105) C’est assez amusant ce silence campé de prime abord, quand on sait quelle fête le héros va rencontrer au climax de son histoire. Le silence agit donc comme les ténèbres premières. Le son et la voix comprise dedans mais non saisis, capables de jaillir. Ce décor sonore est intéressant car il nous livre le son d’un monde, il nous rapporte son bruitage. Et les craquements nous donnent conscience que nous sommes dans un très vieux monde, que nous héritons d’un vieux monde qui nous préexiste. Cela renforce également le sentiment qui court tout au long du livre, d’un livre nostalgique de ce qui s’achève sous ses pieds, d’un livre ayant l’intuition d’une chute de sa matière, le monde justement, le monde d’avant la modernité, d’avant le modernisme, d’avant la guerre.
Il n’y a pas que les silences et les craquements du monde. Il y a aussi les silences et les paroles des héros. Il y a beaucoup de non-dit. Nous sommes dans le monde de la conscience collective, celui où les gens avaient le sentiment d’appartenir à une aventure collective, la société rurale du début du XIXème siècle (Gustave Thibon en parle très bien.) Les émotions sont en deçà, le récit ne fait que montrer les rides à la surface nous dit le préfacier (Sophie Basch). « On avait décidé, pour ne pas le pousser à la révolte, de ne rien demander au fugitif. Et il profita de cette trêve pour ne pas dire un mot. » (ibid p81) Tout le monde comprend ce qui tourmente Meaulnes, personne ne commente. Ce roman apparait aussitôt comme un « Anti-Freud », Alain-Fournier ne va pas raconter l’horizontalité des « cela me fait quelque chose quelque part… » Et se vautrer dans la glose des émotions. Non pas par dignité ou esprit chevaleresque, mais parce que l’écriture est une parole en acte : on dit les choses et ces choses se déroulent tel qu’on le dit, c’est ce qui la rend d’ailleurs verticale. L’efficacité de l’écriture réside dans le fait de livrer une vérité dont le sens est accessible par l’histoire, la succession des événements, et non en faisant des discours, des raisonnements expliquant l’origine des émotions, les significations, etc. comme la modernité va nous y faire baigner. On ne dit pas tout ce que l’on ressent. On sait que la parole ne relierait pas davantage que le silence. Le regard posé est toujours mieux qu’un raisonnement, une parole extraite mieux qu’un dialogue retranscrit.
Ouvrons une parenthèse sur le « Le Hou-ou ! » de Frantz de Galais. Ce son qui traduit la promesse du grand Meaulnes à Frantz de lui ramener sa fiancée. Ce son qui n’est pas une parole, qui n’est pas un cri, mais juste un signal, le signe du départ, de l’aventure, de l’engagement, de l’esprit chevaleresque, de la fidélité. Ce son dit tout cela, c’est un déclencheur d’aventure et de chaos, de départ. C’est le Hou-ou de la conscience, le Hou-ou, réveil de celui qui pourrait se contenter d’une vie plus confortable. Et Meaulnes demande à Yvonne d’être complice de son départ donc de son malheur, en couvrant ce son par celui du piano : « Le jour tombe, dit-il enfin. Je vais fermer les volets. Mais ne cessez pas de jouer… » (ibid p253).
Venons-en maintenant à François, notre jeune conteur. La parole du narrateur n’est pas retranscrite au début du roman. François campe sur une posture de témoin, il en va de sa crédibilité de narrateur, il se tient à distance grâce à son silence. Il semble d’ailleurs ne pas répondre aux phrases qui lui sont adressées. Ce qui traduit aussi l’étanchéité qui existe entre des gens qui font société (les adultes ou les enfants en bande) et l’individu qui observe jusqu’à ce qu’il ait de quoi raconter. Il tient un journal en quelques sortes, il nous fait partager sa vie intérieure. Deux phrases du narrateur à la fin du chapitre IV seulement sont retranscrites, il est comme forcé, comme s’il ne pouvait pas faire autrement que de se faire parler pour camper l’événement banal de la venue des grands-parents par la gare de Vierzon, l’événement banal qui est la cause première. Et la seconde fois pour interroger Meaulnes sur le fameux gilet de soie, relique de son rêve, puis pour le faire patienter une saison de plus avant d’y retourner. La parole du narrateur ne reviendra qu’en seconde partie, page 146 lors de l’embuscade avec les enfants et Frantz de Galais en bohémien : « Nous les tenons, c’est une impasse. » crié par François. Puis lors de la discussion avec Frantz dans la salle de classe, et une dernière phrase quand il s’agit d’étudier la carte. Au total cinq paroles depuis le début du roman. Le reste c’est de la voix off et savourons ensemble cet oxymore : voix off. Une voix éteinte. C’est que la voix off est en fait un appel à la lecture à haute voix, la lecture publique, pour les autres. François écrit son histoire, mais il faut quelqu’un pour faire la voix off, il compte sur le lecteur. Le récit incite à la participation du lecteur hissé au rang de narrateur pour faire fonctionner avec efficacité l’histoire. Il faut que l’on se la raconte cette histoire. Et je pense à mon beau-père qui avait eu la chance d’entendre ce roman lu en classe par Pierre Gardeil au lycée de Lectoure.
A partir du troisième chapitre, la parole vivante de François, le narrateur, va n’avoir de cesse que de s’amplifier. Le narrateur va se citer, se dire. Ce n’est d’ailleurs pas le seul élément qui laisse à penser que nous basculons au cœur de ce chapitre dans un autre style de roman. Comme si toute la construction passée de la tragédie tendait à se lézarder pour laisser poindre quelque chose de plus moderne, comme si l’auteur avait du mal à tenir le cap fixé, ou plus exactement, comme s’il voulait démontrer l’impossibilité désormais de tenir ce cap. Le cap de la parole efficace que l’on appelle Verbe, le cap de la contemplation sous-tendue par le silence premier. Mais je parle de lézarde apparente et non d’effondrement. Le Grand Meaulnes ne supporterait pas de droit d’inventaire. Il s’agit d’un bloc, un bloc qui intrigue parce que la vérité s’y trame.
Retenons donc sur ce thème du silence, des bruits et de la voix off, l’évocation d’un vieux monde dont on hérite mais qui craque, la volonté de livrer le sens par le récit des faits et non par la glose des émotions, la voix off qui associe le lecteur à l’efficacité du récit et enfin le narrateur qui, devenant bavard, dévoile les failles de l’écriture et du monde.
II l’aventure et la narration
Le deuxième thème choisi pour nourrir mon intuition, celle d’avoir à faire à une tentative de tragédie, s’appelle l’aventure et la narration. Et je devrais même dire l’aventurier et le narrateur, tellement ce sont les rôles et non les faits qui me passionnent ici. C’est la nature du personnage qui définit la nature de ses actions. Un aventurier ne vivra que des aventures. C’est le propre de son agir. A son passage, comme par magie, les choses se magnifient, la réalité se drape de sens. L’aventurier préexiste, on nous l’annonce. Aussitôt à son arrivée à l’école, Meaulnes est dit « le grand Meaulnes », et avant d’endosser le costume du héros romantique en quête de son rêve, il devient la star de la classe, dirait-on aujourd’hui. Le héros se moque de l’ordinaire, il est le complice de l’écrivain, pour lui, la vie ordinaire est un leurre. Il y a un rapport immédiat entre sa volonté et la transformation du monde, entre sa volonté et l’écriture d’un roman, qui est la création d’un monde. On lit dans le roman : Meaulnes était « mystérieux, étranger, au milieu de ce monde inconnu, dans la chambre qu’il avait choisie. » (ibid p127) C’est ce choix qui fait de lui un aventurier, le fait de faire usage de la liberté. Un héros est un être vertical. Pourquoi vertical ? Parce qu’il semble vouloir se relier à ce qui n’existe pas, qui n’existe pas pour les autres, mais qui existe pour lui. Il est relié au lieu qui est ce château en ruine rempli de fête, à la jeune fille Yvonne et à l’amour lui-même, ce sentiment qu’il cherche à cultiver. Le héros est un homme vertical car il est également relié à la mort. Il s’élève au-dessus du confort pour se mettre en quête, cette quête étant davantage l’objectif que le lieu, Yvonne, ou l’amour. L’aventure pour l’aventure ? Non. L’aventure comme question nécessaire à poser depuis qu’il a vu la réponse définitive un jour de noce dans cet étrange château. Le but de la vie est de parvenir à poser la bonne question, c’est pourquoi l’aventure devient elle-même chemin et but. Le héros est donc vertical car relié. « Pour celui qui ne veut pas être heureux, il n’a qu’à monter dans son grenier et il entendra, jusqu’au soir, siffler et gémir les naufrages. » (ibid p244) Et cette phrase écrite par le narrateur comme pour éloigner le mauvais sort de la nature de son héros, pour préserver son bonheur, apparait comme une prémonition. Plus loin dans ses lettres où il raconte sa vie à Paris, Meaulnes écrit : « Il me vient cette pensée affreuse que j’ai renoncé au paradis et que je suis en train de piétiner aux portes de l’enfer. » (ibid p282) Le héros est relié, mais il avance à tâtons. Comme le Saint.
Là encore, le roman se place en opposition à la tentation romantique accentuée par l’avènement du tout psychanalytique, de se noyer dans le marécage de l’ego et de ses ressentis. Le héros d’Alain-Fournier est l’anti-narcisse. S’il se penche sur l’eau, ce n’est pas pour se mirer mais pour plonger, s’il s’approche d’un miroir, ce n’est pas pour s’admirer mais pour passer au travers. Rien de moins héroïque qu’un nombril. Il y a aussi un point essentiel à soulever autour d’une des caractéristiques du héros : être un inadapté. Il s’agit à la fois d’un point commun entre le héros romantique et le héros tragique et un moyen de les distinguer. Se sentir inadapté, c’est la douce et orgueilleuse souffrance des romantiques. Ce qui leur permet de se révolter contre le monde. Mais une fois l’humanisme arrivé à son triomphe, cette inadaptation devient un blasphème et il est requis, prescrit par l’ordre nouveau, soit d’être heureux, soit de « se faire suivre ». Meaulnes, l’inadapté, le héros que je veux tragique, refuse le bonheur et son évidence, et ne souhaite ni changer le monde ni changer lui-même. C’est peut-être en ça que la figure romantique ne me semble pas tout à fait adaptée. Il veut tisser son retour, boire la coupe jusqu’à la lie, incarner la tragédie, comme à l’antique.
Revenons au lien entre l’aventure et la narration. L’aventurier vit pour être raconté, plus que pour raconter lui-même. Il semble plutôt dire sans-cesse : si vous saviez, un jour vous saurez, vous verrez… c’est la posture de Meaulnes quand il revient en classe parmi ceux qu’il ne reconnaît plus comme ses semblables. L’aventurier convoque en quelque sorte le narrateur, et l’écrivain tire les ficelles. Alain-Fournier a choisi son héros et semble considérer Frantz de Galais comme un modèle et transforme le modèle en brouillon. Il y a une sorte de pureté romantique justement chez Frantz : naïveté, utopie, suicide raté, égoïsme exacerbé, bonheur doucereux. Le vrai héros est peut-être bien Frantz de Galais. « Je préfère vous prévenir, je ne suis pas un garçon comme les autres. Il y a trois mois, j’ai voulu me tirer une balle dans la tête. » et plus loin : « Je voulais mourir. Et puisque je n’ai pas réussi, je ne continuerai à vivre que pour l’amusement, comme un enfant, comme un bohémien. » (ibid p159) Le Hou-ou ! de Frantz de Galais fait penser à un coup de flûte de pan de Peter Pan. Son qui est une marque indélébile d’assujettissement du Grand-Meaulnes à la folie du jeune garçon, à son égoïsme ? Initialisé à la fin du chapitre IV de la deuxième partie, il ouvre une parenthèse dans laquelle Meaulnes peut avoir une aventure, et la refermera. Sauf qu’au moment où cette parenthèse se referme, c’est Frantz qui entre dans sa petite maison de bonheur et sort de l’aventure, tandis que Meaulnes emporte sa fille pour chercher plus loin encore à se relier. L’écrivain se trompe-t-il de héros, ou joue-t-il avec nos représentations du héros ? Hésite-t-il vraiment ? Cette hésitation du narrateur entre deux héros se prolonge par l’hésitation qu’il a de rentrer lui-même dans l’aventure. Le narrateur a un doute. A-t-il choisi le bon héros ? Ne s'est-il pas trompé ? A la fin de la deuxième partie, François qui raconte, avec le sentiment de trahir, l’histoire du Grand Meaulnes à ses camarades, confesse : « Est-ce que je raconte mal cette histoire ? Elle ne produit pas l’effet que j’attendais. » (ibid p 189) Tout le doute de l’écrivain est ici. Son doute vis-à-vis de son projet, peut-être projet de tragédie comme j’en ai l’intuition, et dont il craint qu’il soit lu avec les yeux de ceux qui veulent faire mourir l’ancien monde, de ceux qui, ayant été romantiques, finissent par croire au progrès. Il doute, et à partir de ce moment là, il fait rentrer le narrateur dans l’aventure, il met ses héros en second plan. Le narrateur tente d’être lui-même héros en basculant lui-même d’abord dans la compassion, puis dans la souffrance. Je ne pense pas que ce soit pour se soumettre à l’air du temps, je ne pense pas que c’est parce qu’il vivait en sa chair ce fameux progrès. Non, j’ai le sentiment qu’il forme un piège, qu’il renverse le piège. Ne pas être bien lu, pas bien compris, est un piège pour un écrivain, il le dit, et le renverse en piégeant ceux qui pensaient enfermer ce récit comme le dernier des récits romantiques, comme l’anticipation d’une nostalgie charmante. L’annonce de cette transformation dans le récit par l’expression du doute de l’écrivain ne peut traduire qu’une intention. Il va jouer avec la littérature, les genres, les critiques littéraires, il va échapper aux lectures de son temps.
Le narrateur tente même de nous faire croire qu’il n’est que témoin et utilise les lettres pour raconter. Ce sont des leurres et paravents pour l’écrivain. L’écrivain qui se piège lui-même de temps en temps en faisant rapporter par son narrateur des propos qu’il n’a pas pu entendre, quand bien même Meaulnes aurait raconter son expérience comme on écrit un livre. C’est plus fort que lui, l’écrivain est un narrateur et passe au dessus du narrateur qu’il a créé dans son histoire pour mieux raconter que lui. Il y a des parties de monologue intérieur retranscrites qui traduisent bien le fait que toute narration est un leurre. Que tout récit, tout roman n’est qu’une histoire racontée. L’histoire des lettres à la fin est assez amusante au regard des transferts. L’écrivain ne supporte pas de ne pas intervenir et prend la place du narrateur, et le narrateur ne supporte plus de ne pas vivre et trahit pour entrer dans l’aventure, et c’est à ce moment là que pour finir le roman, on a besoin que le héros lui-même devienne narrateur et raconte l’histoire.
Que retenir de tous ces rapports entre écrivain, narrateurs et héros ? D’une part qu’il n’y a pas d’aventure sans aventurier, et pas de narration sans aventurier. Le héros préexiste, qu’il est l’être relié à l’invisible et qui retourne vers l’invisible, qui revendique son inadaptation pour avoir droit à l’aventure, et non pour se guérir ou guérir le monde. Ensuite, comme toujours que la narration est une parole efficace au sens où elle crée des mondes. Puis qu’Alain-Fournier a joué avec ses trois dimensions, sans doute pour construire un livre unique, réaliser un acte de récapitulation de ce qu’est écrire. Qu’il a voulu incorporer à l’appareil du récit l’acte d’écrire.
III Le monde banal et le monde extraordinaire
Notre troisième éclairage concerne les relations entre le monde banal, ordinaire, et le monde merveilleux ou extraordinaire. Rappelons-nous du seul mot que mon beau-frère a prononcé : onirique. L’atmosphère merveilleuse est une des choses que les lecteurs retiennent de leur collège ayant dû sans doute faire un exercice sur la reconnaissance du champ lexical.
Notons juste des petites choses qui feront écho à nos remarques précédentes. D’une part que ce merveilleux dans le livre fonctionne un peu en trappes, on passe de l’autre côté du miroir par hasard. Mais notons que Meaulnes n’avait rien demandé. On a vu qu’il était aventurier bien avant de tomber en aventure, amoureux, bien avant de tomber en amour, mais il découvre le château, la noce et Yvonne par hasard. Il était perdu et en éprouvait d’ailleurs une blessure d’orgueil. Pour trouver un monde merveilleux, encore faut-il pouvoir se perdre.
Pour que ce monde merveilleux puisse être réel, et cette aventure crédible, les héros sont des enfants. Ils ne connaissent pas les cartes, ils n’ont pas encore conquis le monde. Il est d’ailleurs assez amusant de voir le travail effectué d’abord par François et Meaulnes pour retrouver l’emplacement du château, puis avec Frantz le bohémien, pour achever de tout replacer. Comment se perdre dans un monde où toutes les cartes ont été réalisées ? Comment être un héros désormais ? Dès lors que la carte naît, le héros perd son territoire d’existence. Curieusement, la possibilité du merveilleux reste attachée à la réalité du territoire, sa matérialité. Un héros est l’incarnation par excellence. Il est d’ailleurs notable de s’apercevoir que lorsque les cartes sont connues, si il n’y a plus de chemins à découvrir et que le champ du possible se rétrécit, seule la mort apparait comme une aventure possible. Et c’est d’autant plus une aventure, que ces jeunes gens sont comme des demi-dieux, éternels, ils sont si jeunes et la mort si loin.
Par ailleurs, le monde banal paraît bien hostile aux héros. Notons qu’après le départ des bohémiens qui avait transplanté un peu de ce monde merveilleux au cœur de village, le vide semble absolu à Meaulnes le sage, qui pour la première fois s’agite et se met à crier. Le monde banal est agressif. C’est le monde moderne. Et la réalité contre laquelle désormais on bute. « Il me semblait qu’à chaque pas nous allions buter sur le sol caillouteux et dur de la place et que nous allions tomber. » (ibid p174). Autre temps de dur réveil concerne le narrateur au moment de sa trahison, quand il raconte tout aux autres enfants, au moment où il rentre dans l’histoire. Il raconte et s’il doute de ses qualités de narrateur, ou d’écrivain, c’est qu’on lui répond ainsi : « "C’était une noce, quoi !" dit Boujardon. Delouche en a vue une, à Préveranges, qui était plus curieuse encore. » (ibid p189) Il y a des choses que l’on ne peut pas raconter au risque de tout aplatir, de vulgariser l’aventure, de la rendre banale. C’est insupportable. Le lecteur peut être ce traitre qui ne va pas comprendre un traitre mot au roman et qui va le travestir avec une vision de commentateur politique, de critique littéraire, il y en a même qui en feront un guide vert pour visiter le Berry et la Sologne !
Ce merveilleux est parfois difficile à croire puisqu’il n’est que le produit de la narration. Frantz fait briller les yeux de sa fiancée. Il transforme sa ruine en cour de Versailles. Et la réception n’est jamais assurée, même quand le message est incarné, même quand le messager et le message ne font qu’un. La jeune fiancée a peur de se relier à l’invisible. Elle a peur de l’aventure. Et d’ailleurs quand elle y rentrera, le messager en sortira pour leur bonheur commun. « Elle était persuadée que tant de bonheur était impossible ; que le jeune homme était trop jeune pour elle, que toutes les merveilles qu’il décrivait étaient imaginaires. » (ibid p221)
Une des natures du merveilleux qui nous est proposé est d’être fugace, un temps seulement. Un temps suffisamment long, mais limité néanmoins. Tout le livre est le chemin de retour vers ce merveilleux. Si Frantz se contente du bonheur ici bas, Meaulnes ne cache pas sa déception d’être confronté au bonheur. Ce n’est pas ça dont il avait fait l’expérience. C’est absolument génial de la part d’Alain-Fournier d’avoir appelé le chapitre des retrouvailles (chapitre V de la troisième partie.) : Partie de plaisir. Quelle déception ! « Tout paraissait si parfaitement concerté pour que nous soyons heureux. Et nous l’avons été si peu !… » (ibid p231)
Que retenir de ce rapport entre le monde merveilleux et le monde banal ? Qu’il résulte de la conversion du regard, c’est certain. Que le merveilleux ne correspond qu’à un temps. Que le reste de la vie n’est que retour vers le merveilleux jusqu’à la mort. Que la virtualisation, la conceptualisation du monde ôte à l’aventurier la possibilité de se perdre et donc de recevoir la visite du merveilleux dans sa vie, que la banalité agresse celui qui ne se contente pas d’être heureux, qu’elle lui est hostile.
IV L’enfant héroïque et l’adulte citoyen
Drôle de titre pour ce dernier petit éclairage sur le livre qui nous réunit. Le mot citoyen n’étant jamais employé dans le livre. Et pourtant. Nous avons longuement commenté la figure du héros, de l’inadapté. Nous avons aussi évoqué le caractère taiseux de toute cette société, on parle pour se donner des informations, on n’investit pas beaucoup davantage sa parole et au final, les adultes dans ce monde semblent n’avoir aucun relief, ce sont davantage des fonctions que des personnes, nommées par leur métier. S’ils agissent, ils sont tout au plus des archétypes de la société de l’époque que des personnes, un peu comme les crèches nous les présentent en Provence.
Par ailleurs, le héros se confronte immédiatement aux autres qui forment en réaction vis-à-vis de cette tentative de liberté un collectif hostile. Les enfants groupés, le groupe, incarnent l’hostilité de la banalité vue précédemment. « Rien ne nous rappelait l’aventure de Meaulnes sinon ce fait étrange que depuis l’après midi de son retour nous n’avions plus d’amis. » (ibid p139) On pense à Rimbaud et son poème On n’est pas sérieux quand on a 17 ans : « Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. » Mais le rapport de l’individu au collectif est ici un peu plus violent. Pour chacun, Meaulnes est celui qui permet de vivre par procuration des aventures, et pour le collectif, il est l’ennemi qui blasphème puisqu’il se paie le luxe de refuser le bonheur, la banalité du bonheur.
Autant le fou du roi avait ce rôle autorisé d’être impertinent vis-à-vis de l’autorité, le héros ne parvient pas à être accepté dans le monde moderne, à être autorisé à jouer son rôle. Il ne peut l’être que s’il finit par consentir au bonheur comme Frantz. Notons en conséquence la réaction du héros et de son complice l’écrivain, le gardien de l’écrit, souligné par Sophie Bash dans sa préface : « Le secret est le dernier asile de l’individu face au progrès collectif. »
En conclusion, lisez le Grand Meaulnes et souvenez-vous-en ! Si ce livre a tendance à disparaître de la mémoire des gens, c’est peut-être que l’Education Nationale l’a tout simplement tué, aplati dans une lecture monolithique d’experts en lettres. Souvenez-vous que le Grand Meaulnes est cette tragédie qui défie le monde moderne déjà là, car pensé, qu’il raconte la question qu’il convient de se poser au regard de la réponse qui nous est donnée de toute éternité.
Beaucoup plus que le dernier romantique, Alain-Fournier est un écrivain qui produit un livre pour répondre à la question : qu’est-ce que la littérature ? Alain Santacreu dirait : si le Verbe s’est fait chair, qu’est-ce que la littérature ? En effet, le romantisme est une forme, c’est tout. Le romantisme est un goût. Forme détournée et mise au profit de l’humanisme triomphant, mise au rebut quand cet humanisme a fini de construire ses mythes et s’est jeté à fond perdu dans le progrès. Le Grand Meaulnes n’est pas ce gentil roman nostalgique, au contraire, il défie le monde de la littérature, il défie le monde. Il répond à la question qu’est-ce que la littérature ? par l’exemple. Il revient aux sources du roman.
Le XVIIIème siècle a vu l’émergence de la littérature et des gendelettres. Au cœur même des salons littéraires parisiens, les écrivains n’ont cherché qu’à plaire à une cour construite autour des femmes de lettres. Par cette matriarchie émasculatrice, les écrivains voulaient plaire eux-mêmes et non créer des mondes. Le retour au roman opéré par le Grand Meaulnes est un mouvement contraire. Au XVIIIème siècle, il était de bon ton de se moquer de Monsieur de l’Etre, et bien le grand Meaulnes revendique de traiter de l’Etre.
J’ai retrouvé un morceau d’une lettre d’Alain-Fournier écrite à André Suarès. Je dois dire que cela m’a intrigué et en même temps a renforcé en moi mon intuition sur le choix de la tragédie. « Toutes les fois qu’il me manquait de la ferveur, je reprenais toujours vos livres, comme je reprends la Bible, Robinson Crusoë ou les Hauts de Hurlevent. J’aime votre colère. C’est un profond mouvement de l’âme, puissante comme une ivresse sacrée. En écrivant le Grand Meaulnes, je pensais que mon désir le plus cher était qu’il ne vous déplût point. » (Lettre à André Suarès,1913.) Et j’ai retrouvé cette citation de Suarès qui me semble correspondre aux enjeux du roman et à la relation entre les deux hommes. « La joie de l’art, dans la plus profonde détresse, c’est qu’il invite l’homme à se sentir éternel. Il faut que le cœur sauve le cœur. Qu’importe là-dessus de n’être pas compris ? Le temps viendra de l’être. Et même s’il ne vient pas pour celui qui attend, il n’aura pas perdu la partie divine : il n’aura perdu que l’enjeu délicieux du bonheur. Sans doute il était né pour cette misère solennelle. » (Sur la vie, tome 1 "Note sur deux livres").
Je me permets donc maintenant de plonger tête la première dans le fruit de mon intuition et de comparer le Meaulnes à Perceval. Perceval a découvert le Graal à son insu. Perceval voit passer le cortège du saint Graal et n’ose rien demander. Poser la question à la réponse donnée est une obligation chevaleresque. Le Graal oriente la quête. Meaulnes découvre par hasard la fête dans le château et Yvonne. A la fin du roman, il laisse mourir Yvonne comme Perceval laisse mourir sa mère, il doit partir. L’émergence du merveilleux dans la vie de Meaulnes ressemble un peu à l’incarnation du Christ dans l’histoire de l’humanité. Et le reste n’est que quête de retour au merveilleux, quête du Graal. Combat spirituel contre l’ego, il vit et agit en étant tout extérieur à lui, il se fait actes, il n’est qu’agir. Le problème, l’énigme de la vie, n’est pas de trouver la réponse, mais de poser la question, la bonne question au regard de la réponse qui nous est donnée.
Pour finir la comparaison, insistons aussi sur une divergence qui est pour moi pleine de sens. Yvonne est abandonnée à la fin comme la mère de Perceval, mais sa posture est radicalement opposée à celle de la mère de Perceval (ibid p260). En réponse à François qui suggère qu’Yvonne était la jeune fille à la fin de tous les rêves de Meaulnes, Yvonne répond : « Comment ai-je pu un instant avoir cette pensée orgueilleuse ? » Contrairement à la mère de Perceval, Yvonne a tout saisi. C’est le personnage du livre qui comprend tout, la nécessité de l’aventure, de la quête, c’est la figure même de la compassion. Elle ne meurt pas de chagrin, elle meurt de compassion. Yvonne a quelque chose de la sainte Vierge sur ce point.
Arrêtons-nous là sur cette lecture quelque peu mystique. Ce livre est une démonstration de ce qu’est un roman, et une démonstration que l’écriture du roman est menacée. Sa panthéonisation a tué l’œuvre, l’enseignement dans les collèges l’a aplatie, sans doute une vengeance des gendelettres ! Et cette vengeance a consisté à transformer un roman en chef-d’œuvre, c'est-à-dire un livre que tout le monde connaît, dont beaucoup parlent et que peu ont vraiment lu…




